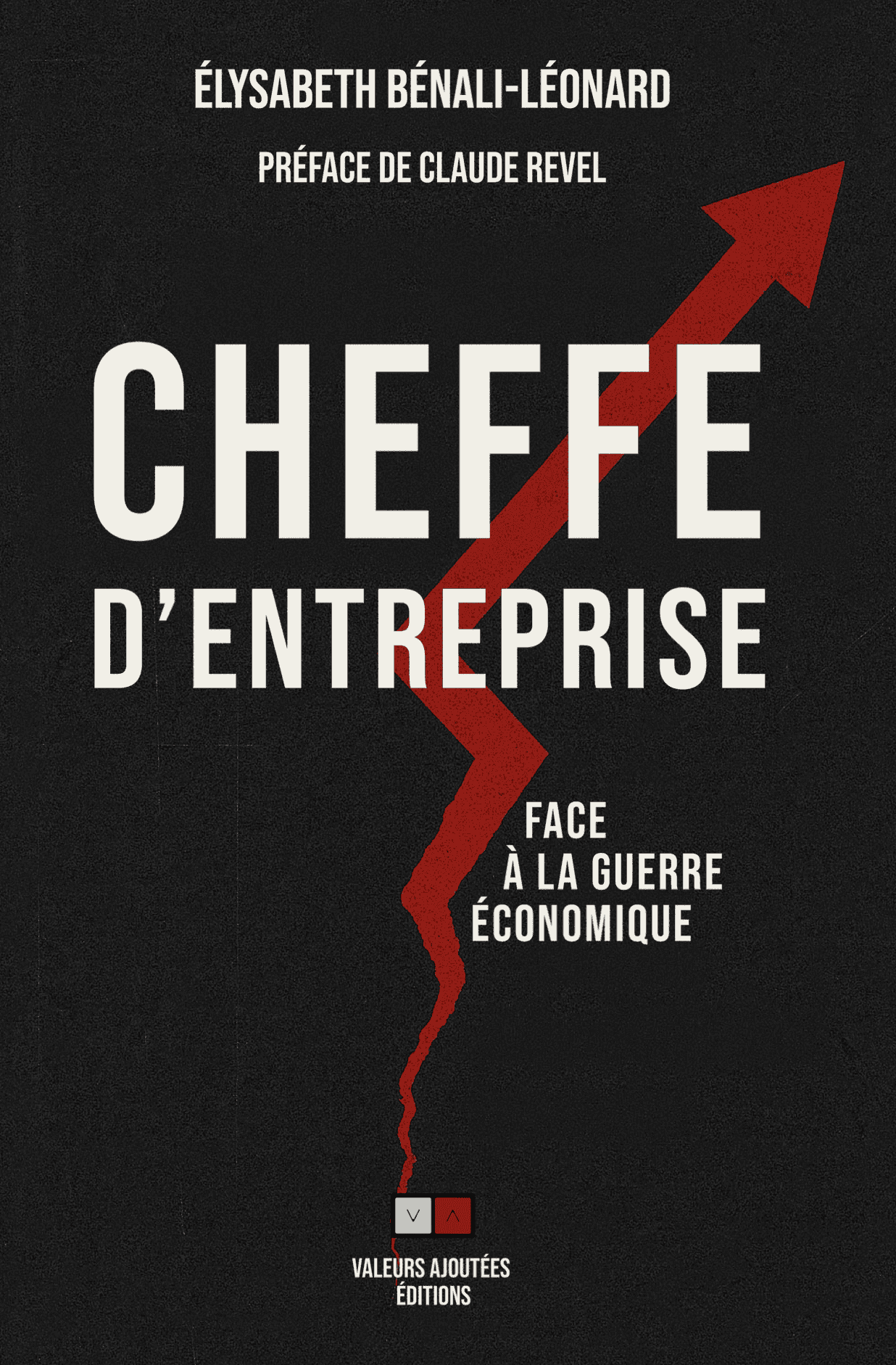Le baiser de Judas - Luca Giordano
Par Landry Richard, président de SEVEN, auteur de "Au-delà des risques " chez Valeurs Ajoutées Éditions.
J’entendais mardi soir un ancien élu de la République, ayant exercé de très hautes fonctions d’État, s’exprimer publiquement en totale contradiction avec la position internationale officielle de la France. Cela m’a rappelé que les plus grandes trahisons françaises demeurent gravées dans la mémoire des amateurs d’histoire comme autant de cicatrices nationales. De Bazaine, maréchal de France accusé en 1873 d’avoir livré Metz à l’ennemi, à Joseph Fouché, figure trouble passée d’un régime à l’autre avec une habileté presque surnaturelle, la trahison a toujours été une notion mouvante, chargée d’enjeux moraux, politiques et stratégiques.
Plus près de nous, l’un des derniers grands cas demeure celui du commandant Pierre-Henri Bunel, officier de l’armée française condamné en 2001 pour avoir transmis des informations confidentielles à une organisation étrangère. Et entre ces épisodes, comment oublier le célèbre quarteron de généraux putschistes d’Alger, accusés de haute trahison en 1961 pour avoir tenté de renverser la République en pleine guerre d’Algérie.
Longtemps, pactiser ou sympathiser avec l’ennemi fut considéré comme l’un des pires crimes contre la République, un acte dont la gravité plaçait son auteur au rang d’ennemi intérieur. En France, la haute trahison et l’intelligence avec l’ennemi restèrent passibles de la peine capitale jusqu’en 1981, année de l’abolition définitive de la peine de mort.
Depuis, la sévérité de la loi n’a pas disparu : elle s’est simplement déplacée.
Aujourd’hui, livrer une portion du territoire national, fournir une aide militaire à une puissance étrangère ou faciliter une agression contre la France reste puni de la détention criminelle à perpétuité. D’autres formes d’intelligence avec l’ennemi, transmission d’informations sensibles, compromission du secret-défense ou aide indirecte à une puissance hostile, peuvent également conduire à la réclusion criminelle à perpétuité. La guillotine a disparu, mais l’idée que trahir son pays constitue l’un des crimes ultimes, elle, n’a jamais cessé d’exister.
À l’ère numérique, la trahison a simplement changé de visage. Longtemps incarnée par l’officier félon, le diplomate acheté ou le conspirateur en uniforme, elle se glisse désormais dans les interstices d’un serveur, derrière l’écran anodin d’un ordinateur professionnel. La fuite d’un fichier peut provoquer davantage de dégâts qu’un bataillon mal placé sur une carte. Les secrets industriels, militaires ou diplomatiques, une fois compromis, se traduisent en milliards de pertes et en tensions géopolitiques immédiates. La loyauté ne se mesure plus au drapeau, mais à l’intégrité avec laquelle on manipule l’information.
Les nouveaux traîtres ne ressemblent plus à ceux d’hier. Ils sont analystes du renseignement, ingénieurs en cybersécurité, consultants privés, salariés occupant des postes stratégiques ou simples agents d’influence orientant subtilement l’opinion. Ils n’ont plus besoin de franchir une frontière ni de rencontrer un officier traitant dans l’ombre d’un parc désert. Un accès réseau, un VPN, une adresse chiffrée : trahir n’est plus un geste, c’est un clic.
Dans ce monde où l’information circule à la vitesse de la lumière, la trahison est devenue moins visible, moins romanesque, mais infiniment plus accessible. Les démocraties doivent désormais détecter des actes qui ne laissent aucune trace physique, qui se nichent dans un log informatique ou une anomalie comportementale. Les services de renseignement ont dû réinventer leurs méthodes, renforcer la contre-ingérence numérique, surveiller les signaux faibles, collaborer davantage avec le secteur privé.
Et puis il y a ces figures publiques qui n’ont probablement pas trahi de secrets d’État, n’ont sans doute livré ni codes ni documents classifiés, mais dont le parcours interroge. D’anciens responsables politiques, autrefois au cœur de l’appareil républicain, qui deviennent administrateurs, conseillers ou représentants de puissances étrangères dont les intérêts divergent radicalement des nôtres. Des élus européens qui, après avoir longtemps défendu la voix de la Nation, se retrouvent à vanter la gouvernance d’États dont la transparence démocratique est plus que discutable. Des anciens chefs de gouvernement siégeant dans des conseils d’administration liés à des régimes autoritaires, donnant parfois l’impression d’une loyauté déplacée, ou d’une indulgence sélective.
Ils n’ont sans doute enfreint aucune loi. Ils exercent un droit fondamental : celui de travailler où ils veulent. Pourtant, une gêne demeure. Car la trahison moderne n’est pas toujours un acte : parfois, c’est une posture. Ce n’est pas livrer un secret, mais offrir une respectabilité à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. C’est défendre, sous couvert d’expertise, des récits politiques forgés ailleurs. C’est oublier que certaines fidélités ne sont pas négociables lorsqu’on a exercé le pouvoir.
Cette évolution ouvre un espace que certaines puissances étrangères exploitent avec une habileté remarquable. Elles savent que les démocraties tolèrent désormais ce qu’elles considéraient autrefois comme inacceptable. Elles ont compris que l’ambiguïté stratégique ne coûte plus rien et que le paysage médiatique peut désormais accueillir des discours jadis inimaginables. Elles n’ont plus besoin d’agents clandestins : il leur suffit de tendre un micro à ceux qui, par conviction, opportunisme ou ressentiment, acceptent de relayer leur récit.
Le paradoxe, c’est que certains de ces relais invoquent la liberté d’expression pour justifier des positions qui, autrefois, auraient été perçues comme un alignement tacite sur une puissance hostile. Pourtant, derrière cette revendication sincère en apparence, se cache parfois une ligne rouge insidieuse : la liberté d’expression utilisée comme bouclier pour diffuser des narratifs forgés ailleurs.
Ce glissement interroge notre rapport collectif à la loyauté, à la souveraineté, à la cohérence nationale. Les menaces ne se logent plus seulement dans les actes, mais dans les discours ; plus dans les fuites de documents que dans les récits complaisants qui altèrent, peu à peu, notre capacité à reconnaître l’intérêt national lorsqu’il est attaqué. On pourrait résumer notre époque avec cette phrase de Baudelaire : « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas. ».
Il en va de même des puissances étrangères qui cherchent à influencer les démocraties : leur stratégie n’est plus la contrainte, mais l’invisibilité. Elles avancent masquées, se glissent dans les interstices du débat public, séduisent par des récits simples, amplifient les ressentiments, soutiennent les voix discordantes tout en se présentant comme de simples acteurs du pluralisme.
Ce mécanisme s’appuie sur une fragilité que Gérald Bronner décrit admirablement dans La démocratie des crédules. Selon lui, les sociétés ouvertes ont créé un environnement où toutes les opinions circulent à la même vitesse, mais pas avec la même rigueur. L’espace public, saturé de contenus, récompense l’émotion plutôt que la nuance, la certitude plutôt que l’analyse, la colère plutôt que la complexité. Bronner parle d’un « marché cognitif dérégulé ». Et c’est justement dans ce marché dérégulé que le piège se referme.
Par facilité intellectuelle, par fatigue, par sentiment d’abandon, beaucoup de citoyens, notamment les plus fragilisés, trouvent dans ces discours populistes ou ces narratifs pro-étrangers un écho immédiat. Ils y reconnaissent leurs frustrations, leurs colères, leurs peurs. Le message leur semble clair, simple, rassurant. Comme le rappelle Bronner, l’esprit humain tend à « sélectionner l’information qui confirme ses intuitions » et à éviter celle qui exige un effort critique.
Ainsi, les récits les plus toxiques deviennent audibles, non parce qu’ils sont vrais, mais parce qu’ils sont confortables. Ils offrent une réponse simple à un monde devenu complexe, désignent un coupable évident (les élites, les médias, l’Europe, l’Occident) et promettent une revanche symbolique.
Les puissances étrangères ne créent pas ces fragilités : elles les exploitent. Elles n’inventent pas la colère : elles la dirigent. Elles n’imposent pas un récit : elles amplifient celui qui les sert.
Ainsi, la démocratie n’est pas seulement vulnérable à ceux qui la trahissent activement ; elle l’est peut-être davantage encore à ceux qui, par naïveté ou par désarroi, relaient des idées qu’ils croient libératrices alors qu’elles sont, en réalité, les vecteurs modernes d’une influence hostile parfaitement assumée.
Alors, trahir son pays est-ce encore un crime ?
La loi répond oui : la trahison demeure l’un des actes les plus sévèrement punis du Code pénal, sanctionné jusqu’à la perpétuité. Mais la vraie question n’est peut-être plus juridique. Elle est morale, civique, presque intime. Car la trahison d’aujourd’hui n’a plus le visage spectaculaire d’hier ; elle avance dissimulée, influence nos débats, altère nos convictions, brouille la frontière entre opinion et manipulation. Elle ne se commet donc plus seulement dans le secret d’un bureau ministériel ou d’un état-major : elle se glisse dans nos écrans, dans nos colères, dans nos fatigues, dans notre crédulité.
Et si elle échappe souvent au droit, elle n’échappe jamais à ses conséquences.
Une démocratie ne s’effondre pas seulement sous le poids des ennemis qu’elle voit, mais sous celui des influences qu’elle ne reconnaît plus. Les nations ne sont trahies que rarement par des conspirateurs ; elles le sont bien plus souvent par l’indifférence, l’ambiguïté, la complaisance ou le renoncement.
Alors oui, trahir son pays est encore un crime.
Mais le plus dangereux, aujourd’hui, n’est peut-être pas celui que punit le Code pénal.
C’est celui qui s’accomplit à visage découvert, sous couvert d’opinion, dans l’indifférence générale, celui qui, lentement, patiemment, fait oublier à un peuple où se trouve son propre intérêt.
Et c’est peut-être là, justement, la réussite la plus parfaite de l’influence hostile : faire croire qu’il n’y a plus de traîtres… pour mieux affaiblir la Nation sans qu’elle ne s’en aperçoive.
J’entendais mardi soir un ancien élu de la République, ayant exercé de très hautes fonctions d’État, s’exprimer publiquement en totale contradiction avec la position internationale officielle de la France. Cela m’a rappelé que les plus grandes trahisons françaises demeurent gravées dans la mémoire des amateurs d’histoire comme autant de cicatrices nationales. De Bazaine, maréchal de France accusé en 1873 d’avoir livré Metz à l’ennemi, à Joseph Fouché, figure trouble passée d’un régime à l’autre avec une habileté presque surnaturelle, la trahison a toujours été une notion mouvante, chargée d’enjeux moraux, politiques et stratégiques.
Plus près de nous, l’un des derniers grands cas demeure celui du commandant Pierre-Henri Bunel, officier de l’armée française condamné en 2001 pour avoir transmis des informations confidentielles à une organisation étrangère. Et entre ces épisodes, comment oublier le célèbre quarteron de généraux putschistes d’Alger, accusés de haute trahison en 1961 pour avoir tenté de renverser la République en pleine guerre d’Algérie.
Longtemps, pactiser ou sympathiser avec l’ennemi fut considéré comme l’un des pires crimes contre la République, un acte dont la gravité plaçait son auteur au rang d’ennemi intérieur. En France, la haute trahison et l’intelligence avec l’ennemi restèrent passibles de la peine capitale jusqu’en 1981, année de l’abolition définitive de la peine de mort.
Depuis, la sévérité de la loi n’a pas disparu : elle s’est simplement déplacée.
Aujourd’hui, livrer une portion du territoire national, fournir une aide militaire à une puissance étrangère ou faciliter une agression contre la France reste puni de la détention criminelle à perpétuité. D’autres formes d’intelligence avec l’ennemi, transmission d’informations sensibles, compromission du secret-défense ou aide indirecte à une puissance hostile, peuvent également conduire à la réclusion criminelle à perpétuité. La guillotine a disparu, mais l’idée que trahir son pays constitue l’un des crimes ultimes, elle, n’a jamais cessé d’exister.
À l’ère numérique, la trahison a simplement changé de visage. Longtemps incarnée par l’officier félon, le diplomate acheté ou le conspirateur en uniforme, elle se glisse désormais dans les interstices d’un serveur, derrière l’écran anodin d’un ordinateur professionnel. La fuite d’un fichier peut provoquer davantage de dégâts qu’un bataillon mal placé sur une carte. Les secrets industriels, militaires ou diplomatiques, une fois compromis, se traduisent en milliards de pertes et en tensions géopolitiques immédiates. La loyauté ne se mesure plus au drapeau, mais à l’intégrité avec laquelle on manipule l’information.
Les nouveaux traîtres ne ressemblent plus à ceux d’hier. Ils sont analystes du renseignement, ingénieurs en cybersécurité, consultants privés, salariés occupant des postes stratégiques ou simples agents d’influence orientant subtilement l’opinion. Ils n’ont plus besoin de franchir une frontière ni de rencontrer un officier traitant dans l’ombre d’un parc désert. Un accès réseau, un VPN, une adresse chiffrée : trahir n’est plus un geste, c’est un clic.
Dans ce monde où l’information circule à la vitesse de la lumière, la trahison est devenue moins visible, moins romanesque, mais infiniment plus accessible. Les démocraties doivent désormais détecter des actes qui ne laissent aucune trace physique, qui se nichent dans un log informatique ou une anomalie comportementale. Les services de renseignement ont dû réinventer leurs méthodes, renforcer la contre-ingérence numérique, surveiller les signaux faibles, collaborer davantage avec le secteur privé.
Et puis il y a ces figures publiques qui n’ont probablement pas trahi de secrets d’État, n’ont sans doute livré ni codes ni documents classifiés, mais dont le parcours interroge. D’anciens responsables politiques, autrefois au cœur de l’appareil républicain, qui deviennent administrateurs, conseillers ou représentants de puissances étrangères dont les intérêts divergent radicalement des nôtres. Des élus européens qui, après avoir longtemps défendu la voix de la Nation, se retrouvent à vanter la gouvernance d’États dont la transparence démocratique est plus que discutable. Des anciens chefs de gouvernement siégeant dans des conseils d’administration liés à des régimes autoritaires, donnant parfois l’impression d’une loyauté déplacée, ou d’une indulgence sélective.
Ils n’ont sans doute enfreint aucune loi. Ils exercent un droit fondamental : celui de travailler où ils veulent. Pourtant, une gêne demeure. Car la trahison moderne n’est pas toujours un acte : parfois, c’est une posture. Ce n’est pas livrer un secret, mais offrir une respectabilité à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. C’est défendre, sous couvert d’expertise, des récits politiques forgés ailleurs. C’est oublier que certaines fidélités ne sont pas négociables lorsqu’on a exercé le pouvoir.
Cette évolution ouvre un espace que certaines puissances étrangères exploitent avec une habileté remarquable. Elles savent que les démocraties tolèrent désormais ce qu’elles considéraient autrefois comme inacceptable. Elles ont compris que l’ambiguïté stratégique ne coûte plus rien et que le paysage médiatique peut désormais accueillir des discours jadis inimaginables. Elles n’ont plus besoin d’agents clandestins : il leur suffit de tendre un micro à ceux qui, par conviction, opportunisme ou ressentiment, acceptent de relayer leur récit.
Le paradoxe, c’est que certains de ces relais invoquent la liberté d’expression pour justifier des positions qui, autrefois, auraient été perçues comme un alignement tacite sur une puissance hostile. Pourtant, derrière cette revendication sincère en apparence, se cache parfois une ligne rouge insidieuse : la liberté d’expression utilisée comme bouclier pour diffuser des narratifs forgés ailleurs.
Ce glissement interroge notre rapport collectif à la loyauté, à la souveraineté, à la cohérence nationale. Les menaces ne se logent plus seulement dans les actes, mais dans les discours ; plus dans les fuites de documents que dans les récits complaisants qui altèrent, peu à peu, notre capacité à reconnaître l’intérêt national lorsqu’il est attaqué. On pourrait résumer notre époque avec cette phrase de Baudelaire : « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas. ».
Il en va de même des puissances étrangères qui cherchent à influencer les démocraties : leur stratégie n’est plus la contrainte, mais l’invisibilité. Elles avancent masquées, se glissent dans les interstices du débat public, séduisent par des récits simples, amplifient les ressentiments, soutiennent les voix discordantes tout en se présentant comme de simples acteurs du pluralisme.
Ce mécanisme s’appuie sur une fragilité que Gérald Bronner décrit admirablement dans La démocratie des crédules. Selon lui, les sociétés ouvertes ont créé un environnement où toutes les opinions circulent à la même vitesse, mais pas avec la même rigueur. L’espace public, saturé de contenus, récompense l’émotion plutôt que la nuance, la certitude plutôt que l’analyse, la colère plutôt que la complexité. Bronner parle d’un « marché cognitif dérégulé ». Et c’est justement dans ce marché dérégulé que le piège se referme.
Par facilité intellectuelle, par fatigue, par sentiment d’abandon, beaucoup de citoyens, notamment les plus fragilisés, trouvent dans ces discours populistes ou ces narratifs pro-étrangers un écho immédiat. Ils y reconnaissent leurs frustrations, leurs colères, leurs peurs. Le message leur semble clair, simple, rassurant. Comme le rappelle Bronner, l’esprit humain tend à « sélectionner l’information qui confirme ses intuitions » et à éviter celle qui exige un effort critique.
Ainsi, les récits les plus toxiques deviennent audibles, non parce qu’ils sont vrais, mais parce qu’ils sont confortables. Ils offrent une réponse simple à un monde devenu complexe, désignent un coupable évident (les élites, les médias, l’Europe, l’Occident) et promettent une revanche symbolique.
Les puissances étrangères ne créent pas ces fragilités : elles les exploitent. Elles n’inventent pas la colère : elles la dirigent. Elles n’imposent pas un récit : elles amplifient celui qui les sert.
Ainsi, la démocratie n’est pas seulement vulnérable à ceux qui la trahissent activement ; elle l’est peut-être davantage encore à ceux qui, par naïveté ou par désarroi, relaient des idées qu’ils croient libératrices alors qu’elles sont, en réalité, les vecteurs modernes d’une influence hostile parfaitement assumée.
Alors, trahir son pays est-ce encore un crime ?
La loi répond oui : la trahison demeure l’un des actes les plus sévèrement punis du Code pénal, sanctionné jusqu’à la perpétuité. Mais la vraie question n’est peut-être plus juridique. Elle est morale, civique, presque intime. Car la trahison d’aujourd’hui n’a plus le visage spectaculaire d’hier ; elle avance dissimulée, influence nos débats, altère nos convictions, brouille la frontière entre opinion et manipulation. Elle ne se commet donc plus seulement dans le secret d’un bureau ministériel ou d’un état-major : elle se glisse dans nos écrans, dans nos colères, dans nos fatigues, dans notre crédulité.
Et si elle échappe souvent au droit, elle n’échappe jamais à ses conséquences.
Une démocratie ne s’effondre pas seulement sous le poids des ennemis qu’elle voit, mais sous celui des influences qu’elle ne reconnaît plus. Les nations ne sont trahies que rarement par des conspirateurs ; elles le sont bien plus souvent par l’indifférence, l’ambiguïté, la complaisance ou le renoncement.
Alors oui, trahir son pays est encore un crime.
Mais le plus dangereux, aujourd’hui, n’est peut-être pas celui que punit le Code pénal.
C’est celui qui s’accomplit à visage découvert, sous couvert d’opinion, dans l’indifférence générale, celui qui, lentement, patiemment, fait oublier à un peuple où se trouve son propre intérêt.
Et c’est peut-être là, justement, la réussite la plus parfaite de l’influence hostile : faire croire qu’il n’y a plus de traîtres… pour mieux affaiblir la Nation sans qu’elle ne s’en aperçoive.

 Diplomatie
Diplomatie