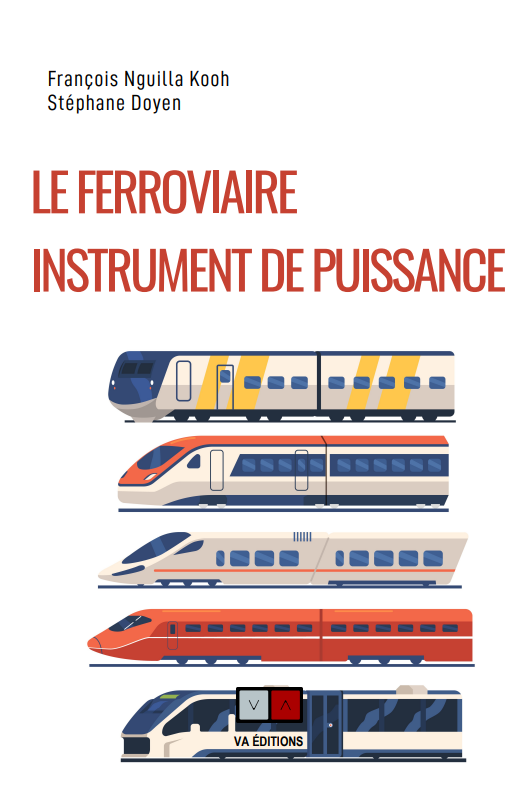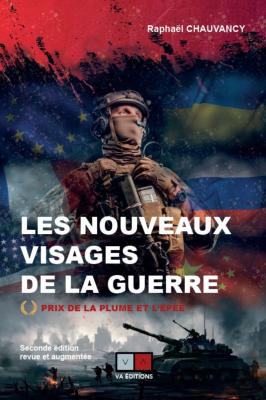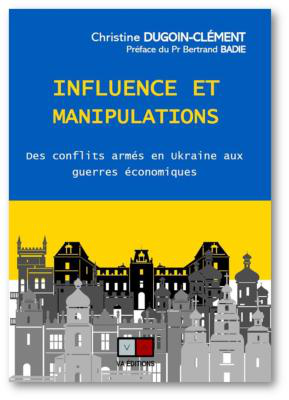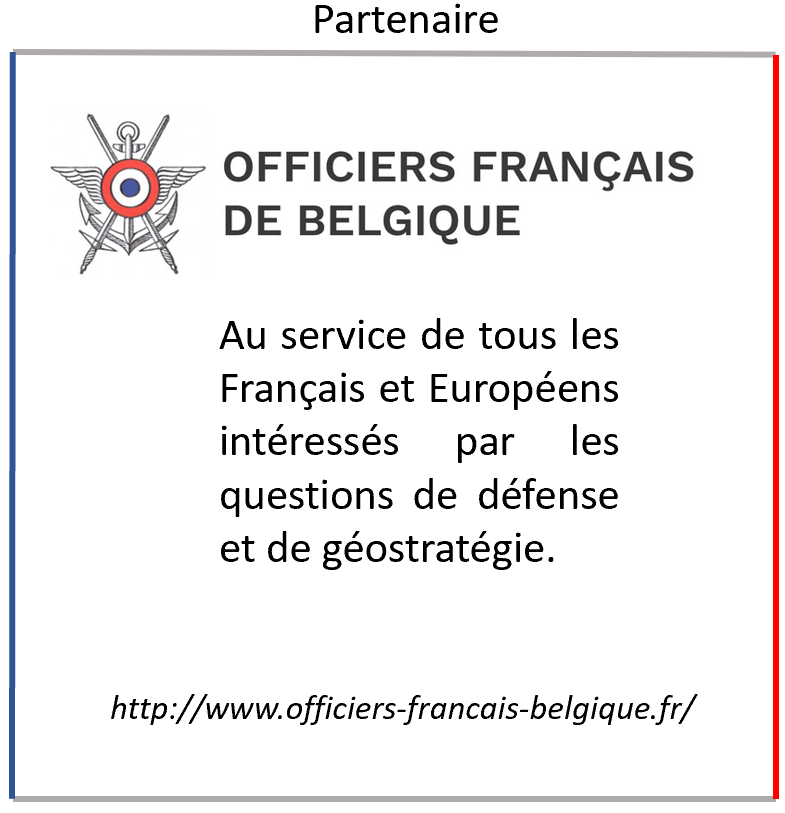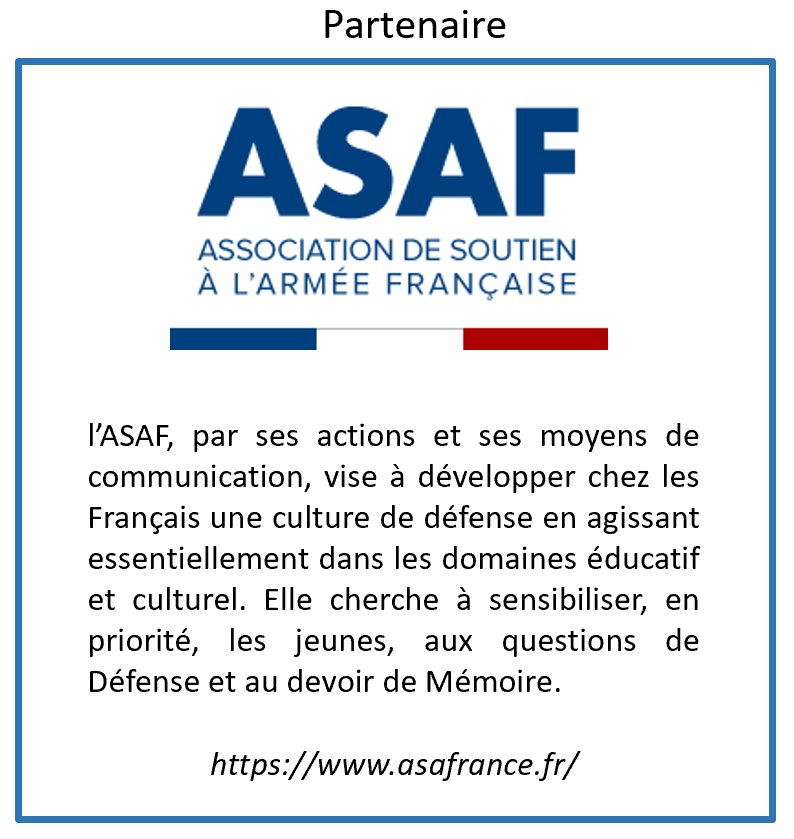L’automne 2025 confirme que le pétrole reste l’un des baromètres les plus fiables de la géopolitique mondiale. Alors que les économies se remettent lentement de deux années de tensions commerciales et de crises d’approvisionnement, l’OPEP+ n’a pas tenu sa promesse : la hausse de production prévue pour stabiliser le marché n’a été réalisée qu’à 75 %. Environ 500 000 barils/jour manquent encore à l’appel, un déficit suffisant pour entretenir une pression durable sur les prix mondiaux.
Derrière ces chiffres se cache une réalité politique : la fragmentation croissante de l’alliance pétrolière. L’OPEP+, dominée par l’Arabie saoudite et la Russie, tente de préserver son unité dans un contexte de rivalités internes. Riyad veut maintenir des prix élevés pour financer sa diversification économique, tandis que Moscou contourne les sanctions occidentales en vendant à prix réduit vers l’Asie. L’union de façade masque des intérêts divergents.
Au même moment, la Chine poursuit discrètement une stratégie d’accumulation de stocks pétroliers. Pékin a profité de la relative accalmie du marché pour remplir ses réserves stratégiques, portant ses capacités de stockage à un niveau record. Cette politique prudente vise à garantir son indépendance énergétique face aux risques de blocage maritime dans le détroit de Malacca ou en mer de Chine méridionale. Elle lui donne aussi un levier géoéconomique : celui d’absorber temporairement une partie de la demande mondiale, influençant les prix et la stabilité des marchés.
Les tensions au Moyen-Orient ajoutent une couche supplémentaire d’incertitude. Le regain de tension entre Israël et l’Iran, après des frappes attribuées à Téhéran sur des infrastructures portuaires, a fait bondir les primes de risque dans le Golfe. L’Arabie saoudite et les Émirats, craignant un embrasement régional, ont momentanément réduit leurs exportations, accentuant la volatilité.
À cela s’ajoute le maintien des sanctions occidentales contre la Russie, qui limite encore la disponibilité des produits raffinés sur le marché européen. Si le Kremlin a trouvé de nouveaux débouchés en Inde, en Turquie et en Chine, les flux restent désorganisés. L’Europe, elle, dépend toujours des importations américaines et norvégiennes, ce qui réduit sa marge de manœuvre.
Le résultat est clair : un marché tendu, dominé par la géopolitique plus que par la logique économique. Les prix élevés alimentent les recettes des producteurs, mais fragilisent la croissance mondiale. Les pays importateurs doivent choisir entre inflation énergétique et récession contrôlée.
La situation souligne la fin d’une illusion : la transition énergétique rapide. Malgré les discours, les économies restent structurellement dépendantes du pétrole et du gaz. L’énergie dite “verte” ne compense pas encore les besoins du système industriel mondial. Dans cette bataille invisible, l’OPEP+ reste un arbitre incontournable, la Chine un acheteur décisif, et l’Occident un acteur contraint. Le pétrole, loin d’être un vestige du passé, demeure l’arme invisible du présent : celle qui relie toutes les puissances, mais ne profite à aucune.
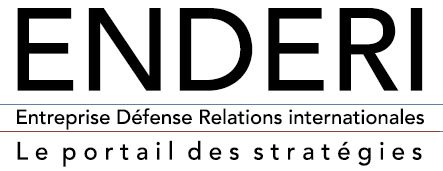
 Diplomatie
Diplomatie