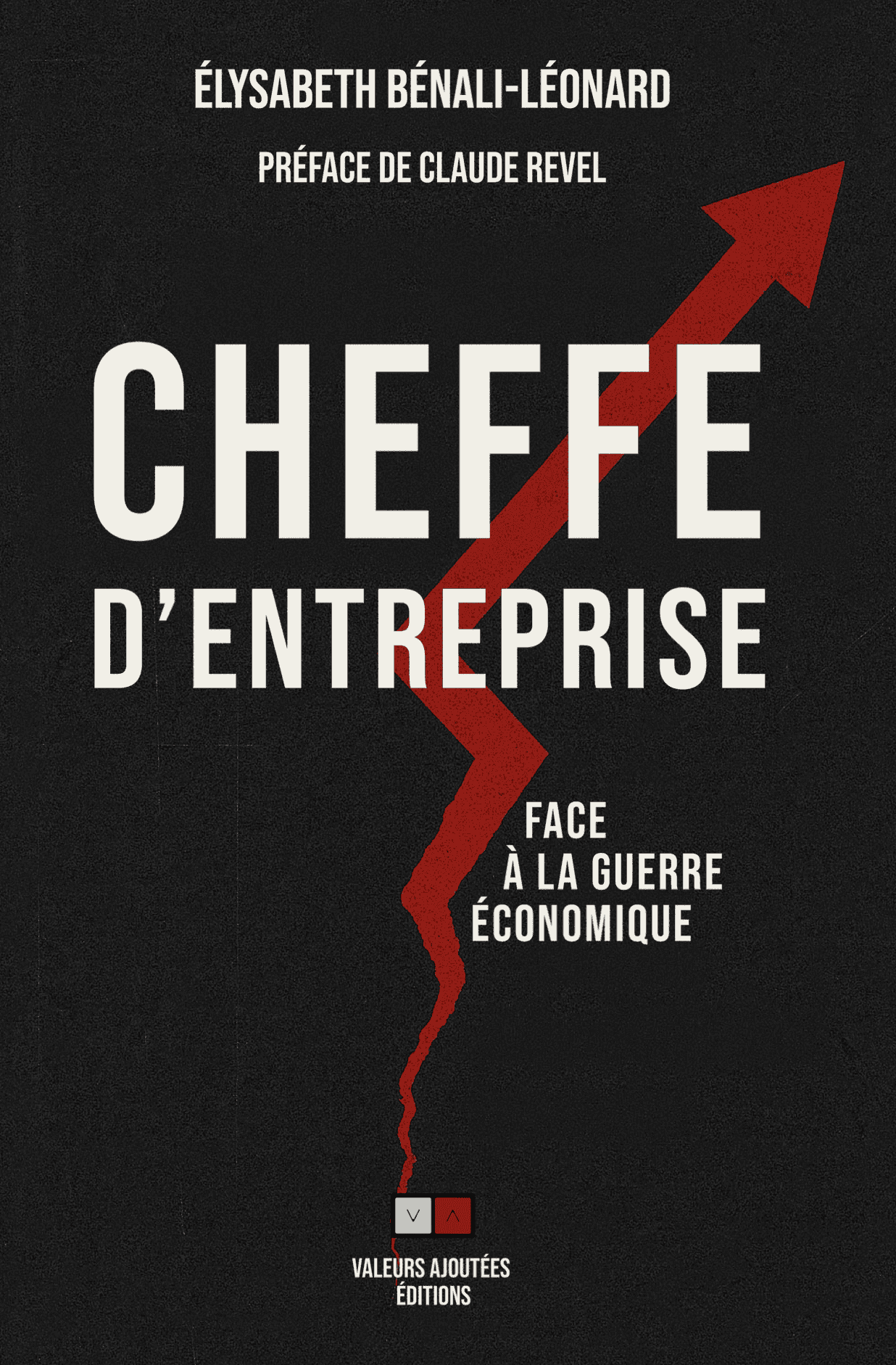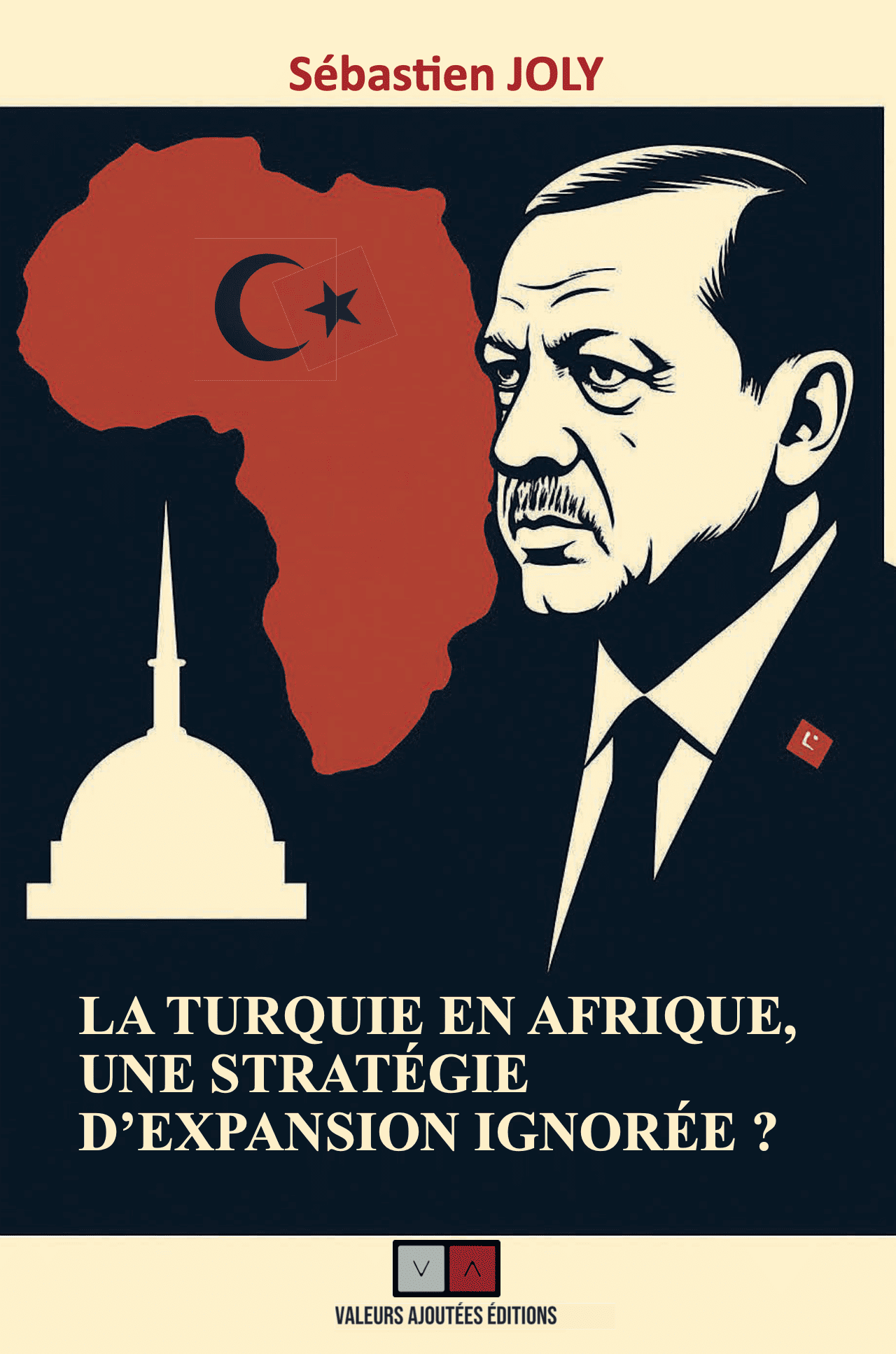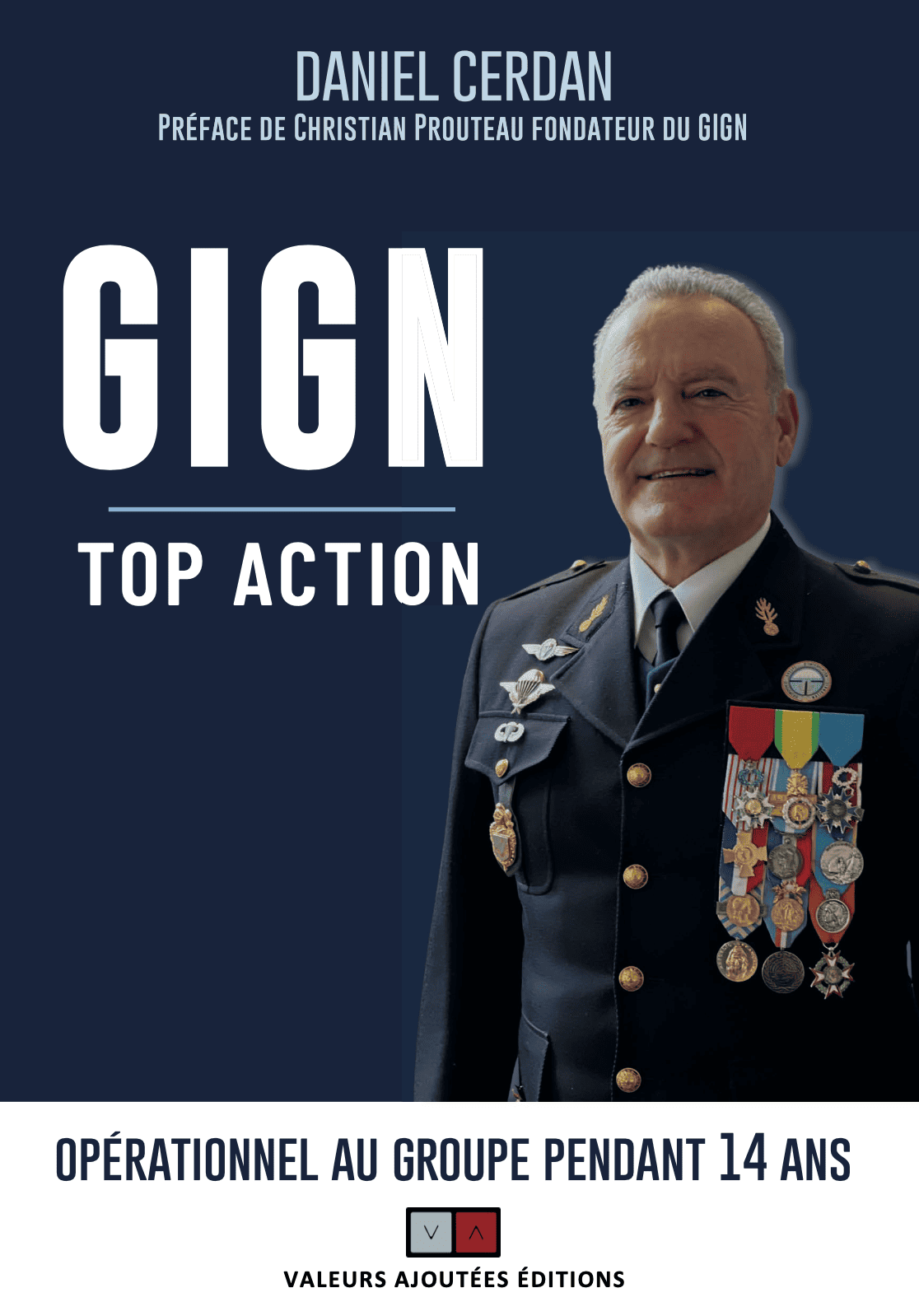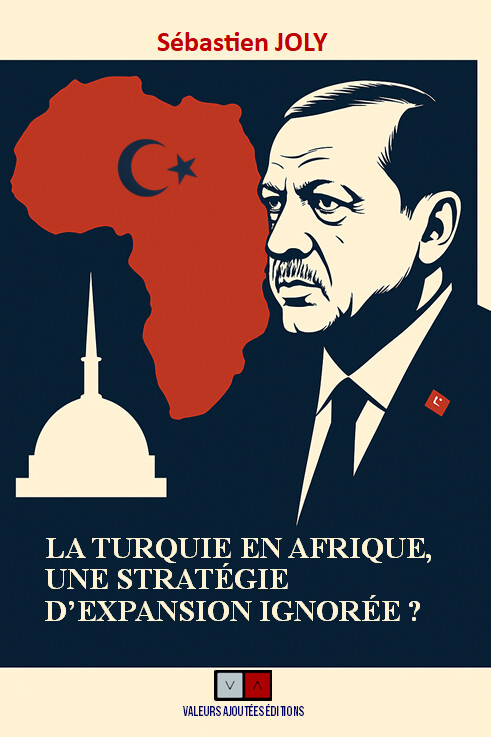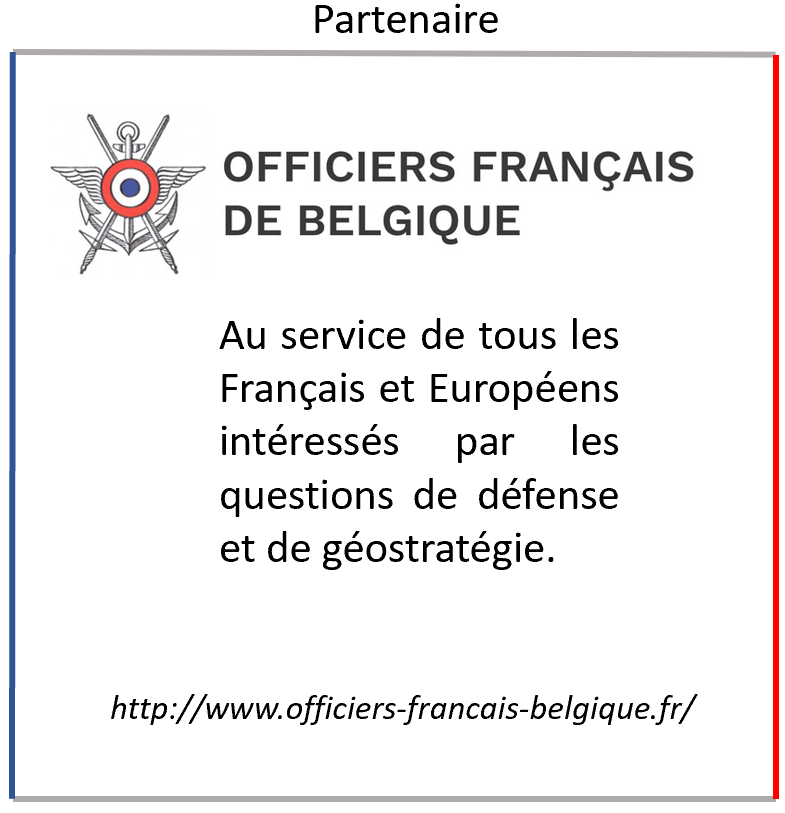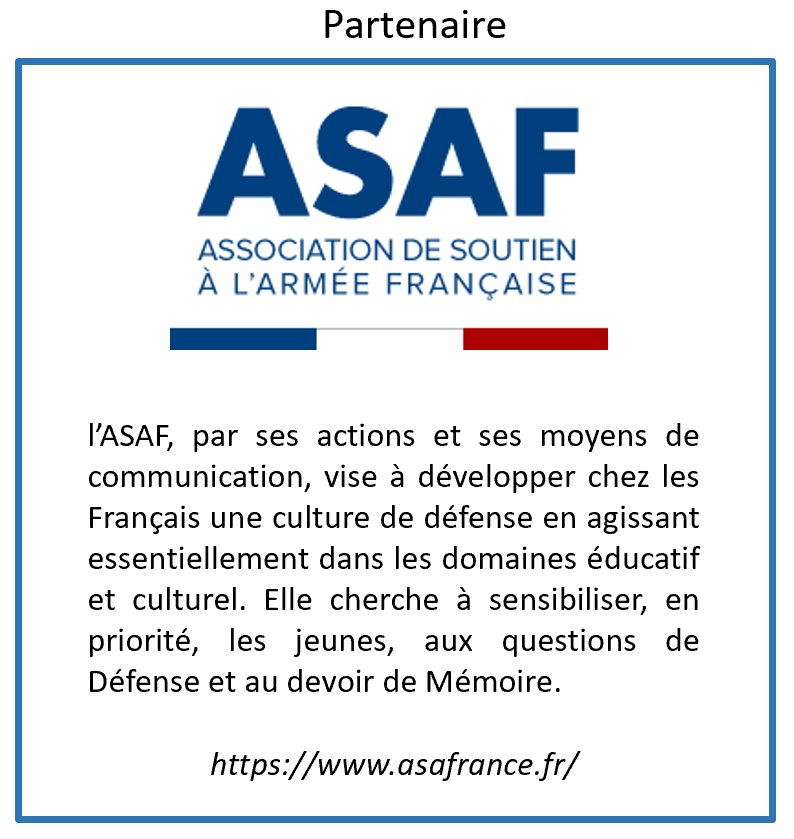Vous montrez dans votre ouvrage que la politique africaine de la Turquie ne s’est pas improvisée : elle s’inscrit dans une stratégie de long terme amorcée dès la fin des années 1990. Qu’est-ce qui, à ce moment-là, a convaincu Ankara que l’Afrique pouvait devenir un axe prioritaire de sa politique étrangère ?
S.JOLY: Pendant la Guerre froide, la Turquie, membre de l’OTAN depuis 1952, était un verrou stratégique contre l’expansion soviétique. La fin de la guerre froide a modifié son rôle géostratégique, réduisant son influence face aux nouveaux États post-soviétiques. Malgré des tensions, la Turquie a valorisé ses ambitions en Eurasie, mais a été freinée par des crises internes. Le refus de l’adhésion à l’Europe en 1997 a incité les élites à promouvoir une politique de multipolarité active, diversifiant ses partenariats. À la fin des années 1990, l’Afrique est perçue comme un terrain d’affirmation de cette indépendance, donnant lieu à un plan d’action vers l’Afrique, finalement appliqué avec l’arrivée de l’AKP au pouvoir. Ahmet Davutoglu, avec son livre « Profondeur stratégique », a théorisé une politique étrangère basée sur l’héritage ottoman. Ce modèle prône une influence culturelle et religieuse intégrant le développement commercial en Afrique, considérée comme un laboratoire pour une nouvelle puissance turque, ancrée dans son histoire. Le tournant africain devient ainsi essentiel dans la réinvention de la puissance turque post-Guerre froide.
Le refus européen de 1997, lorsque Bruxelles rejette la candidature turque à l’adhésion, est souvent considéré comme un tournant diplomatique majeur. Dès l’année suivante, Ankara amorce son ouverture vers l’Afrique. Pensez-vous que le rejet européen a joué un rôle d’accélérateur dans cette réorientation stratégique, ou que la Turquie se serait tournée vers l’Afrique quoi qu’il arrive ?
S.JOLY: La Turquie, jusqu’aux années 1990, se considérait comme une nation occidentale voire appartenant à la famille occidentale en raison de son appartenance à différentes alliances. Depuis 1959, la Turquie candidate pour rejoindre la communauté économique européenne. Mais le refus de l’UE en 1997 pour des raisons politiques (question chypriote, droit de l’homme…) a été perçu comme une humiliation, soulevant des questions d’identité stratégique et entraînant une désillusion envers l’Occident. Cela a conduit à un réalignement diplomatique vers le sud et l’est, avec une ouverture sur le continent africain. Cette réorientation est catalysée par le rejet européen donnant lieu à l’émergence d’un capitalisme anatolien dont certaines entreprises ont des marchés sur le continent africain et à un sentiment d’autonomie nationale, tout en demeurant une candidate à l’UE et membre de l’OTAN. Mais, le rejet de 1997 a conduit à une transformation de la frustration identitaire en une ambition géopolitique, permettant à la Turquie de se positionner plus rapidement et plus fermement sur le continent africain.
La Turquie parle de partenariat d’égal à égal avec l’Afrique. Mais sur le terrain, ce sont surtout ses grands groupes (Yapı Merkezi, Limak, Kalyon ou encore Summa) qui remportent la majorité des marchés publics les plus lucratifs, notamment dans les secteurs du BTP, de l’énergie ou des infrastructures. Cette asymétrie remet-elle en cause la crédibilité du modèle « gagnant-gagnant » ?
S.JOLY: Ce partenariat « gagnant-gagnant » entre la Turquie et l’Afrique, promu par le président Erdoğan, repose sur une diplomatie de respect mutuel et de développement partagé, se démarquant des anciennes puissances coloniales. Bien que cette approche vise une coopération profitable pour les deux parties, elle a conduit à une marginalisation des entreprises africaines, qui subissent la concurrence des entreprises turques soutenues par l’État. Ce phénomène a créé une asymétrie économique, avec la Turquie perçue davantage comme une puissance exportatrice de capitaux. Malgré des investissements dans des secteurs visibles socialement, certains gouvernements africains commencent à renégocier des projets face aux coûts et au faible retour local, ce qui pourrait nuire à la légitimité turque à long terme. Si la tendance se maintient sans intégration des acteurs africains, le modèle turc risque d’être perçu comme un néo-ottomanisme d’affaires.
Malgré cette domination économique, la Turquie conserve l’image d’un partenaire respectueux et pragmatique. Est-ce que cette présence « non arrogante » est aujourd’hui encore crédible, ou commence-t-elle à susciter de la méfiance dans certains pays africains ?
S.JOLY: La Turquie, au cours de la dernière décennie, s’est positionnée comme un acteur alternatif sur la scène diplomatique africaine, se distinguant par une approche respectueuse et un discours de solidarité Sud-Sud. Le président Erdoğan incarne cette diplomatie, favorisant les liens de confiance grâce aux interactions directes qu’il entretient avec les dirigeants africains. À travers le soft power, Ankara utilise des organisations comme Kizilai (croissant rouge turc) et la TIKA pour promouvoir son aide humanitaire et au développement, tout en investissant dans des infrastructures essentielles. Toutefois, depuis 2017, la Turquie a amorcé un virage vers une approche plus interventionniste, marquée par l’établissement de bases militaires et une augmentation des exportations d’armes, prenant ainsi le relais des anciennes puissances coloniales. Cette évolution amène des élites africaines à percevoir Ankara non plus comme un partenaire, mais comme un acteur avec des intérêts géopolitiques, suscitant une certaine méfiance. Malgré une perception globalement positive en raison de son discours anticolonial, la Turquie risque de voir son image de « frère du Sud » ternie au fur et à mesure que ses ambitions stratégiques se précisent.
La Turquie assume désormais une politique d’expansion mondiale inspirée d’une forme de néo-ottomanisme. Jusqu’où peut aller cette ambition ? Peut-elle réellement se hisser au rang de puissance globale, ou restera-t-elle une influence régionale ?
S.JOLY: Le néo-ottomanisme terme décrivant le concept politique introduit par Ahmet Davutoglu, représente l’idée d’une Turquie aspirant à projeter son influence dans les anciens territoires de l’Empire ottoman, en se plaçant comme un leader dans le monde musulman afin de rivaliser avec l’Arabie saoudite et l’Iran. Cela s’est manifesté dans un premier temps par une diplomatie active, la diffusion de soft power et le développement de contrats commerciaux. Après avoir consolidé les fondations, la politique étrangère turque a pris le virage du hard power caractérisé par une politique militaire interventionniste ciblée et un développement d’une industrie militaire nationale. Malgré ses nombreux atouts, la Turquie fait face à des limites économiques et militaires, en plus de tensions politiques avec l’Europe et les États-Unis. Sa position géographique est stratégique, mais son influence globale est sélective et ne lui permet pas de redéfinir l’ordre mondial. En conclusion, la Turquie a des chances de devenir une puissance régionale majeure visant à être un hub énergétique indépendant, mais non une puissance globale complète.
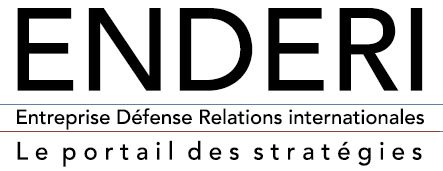
 Diplomatie
Diplomatie