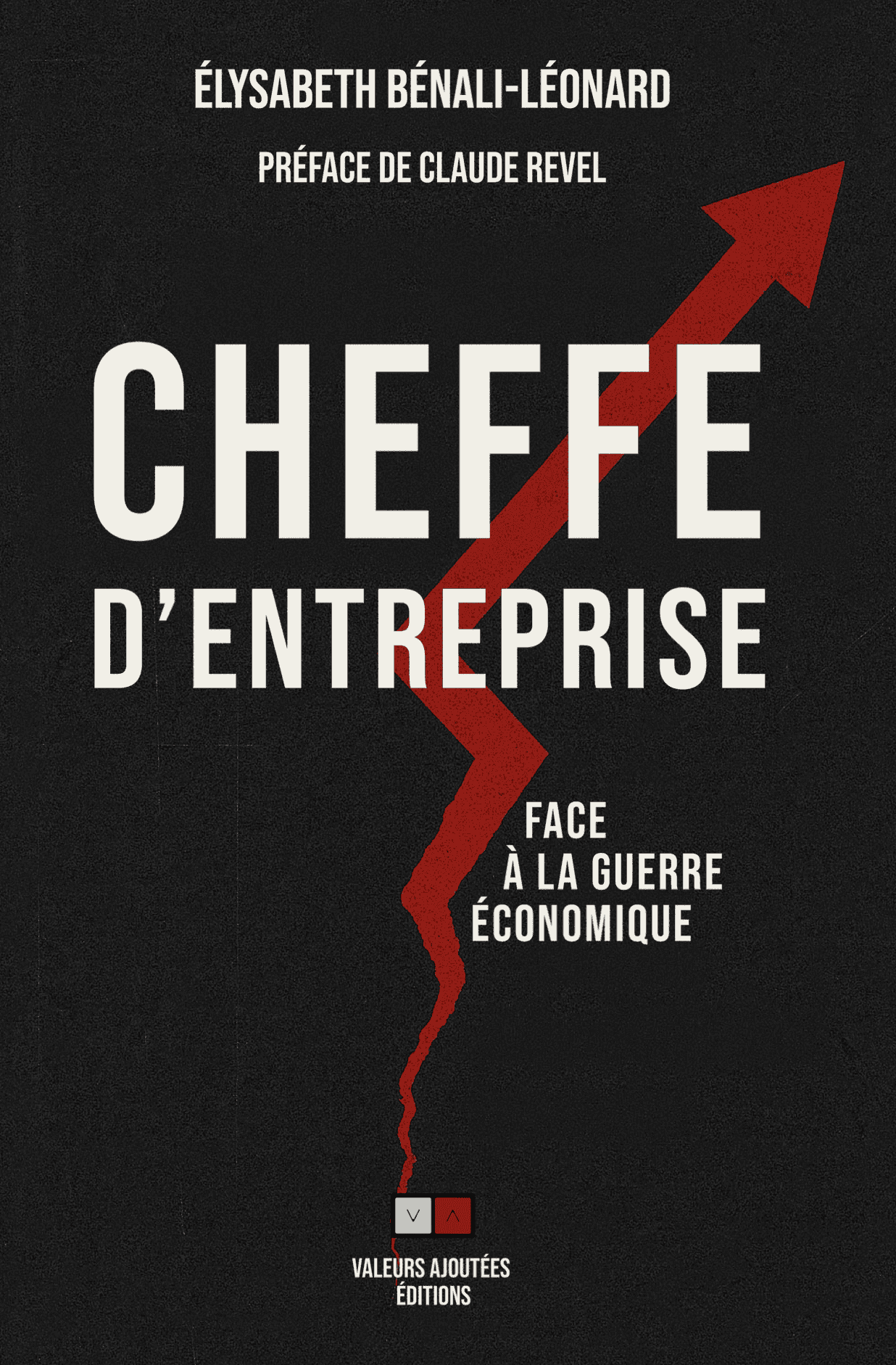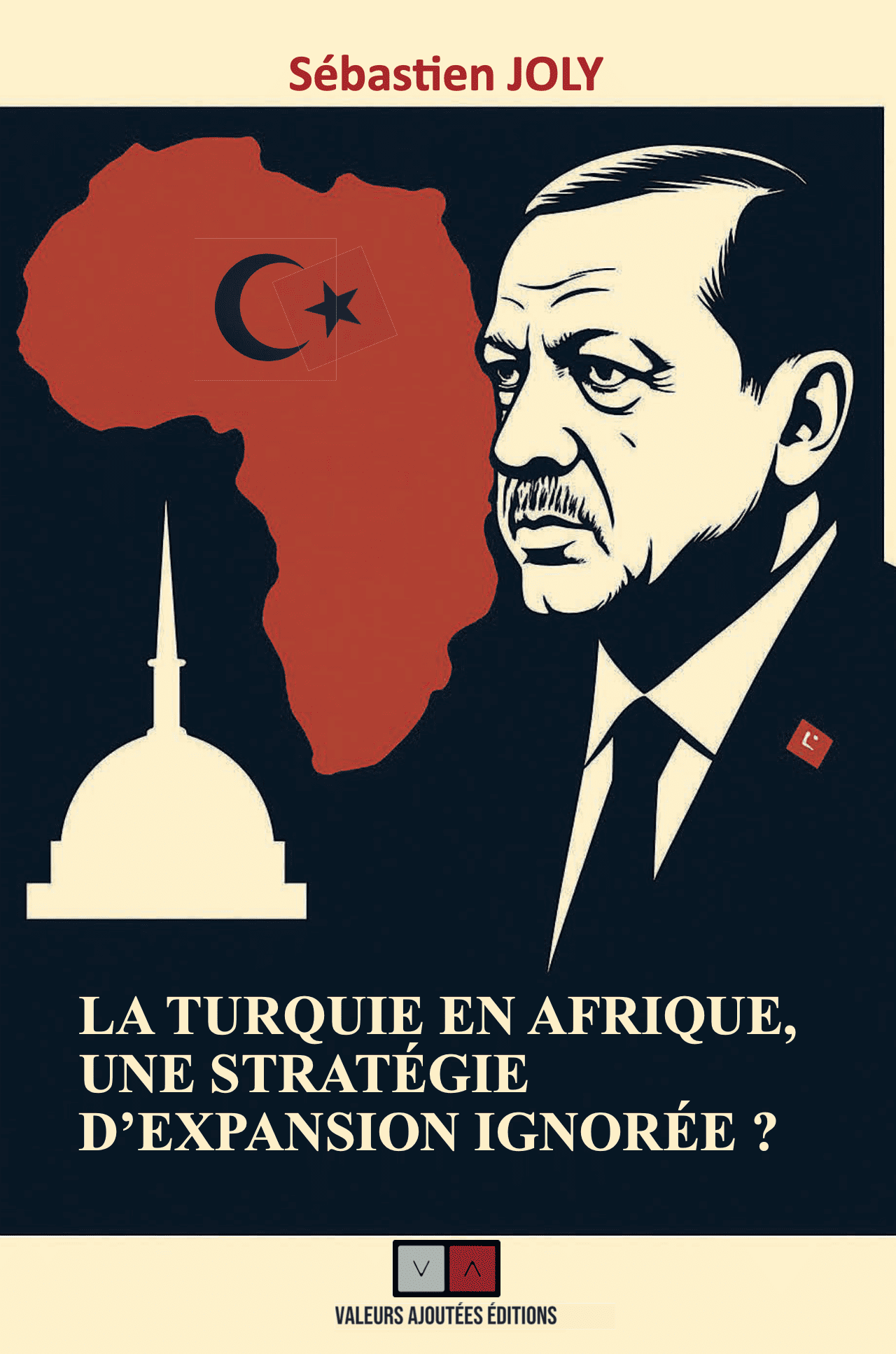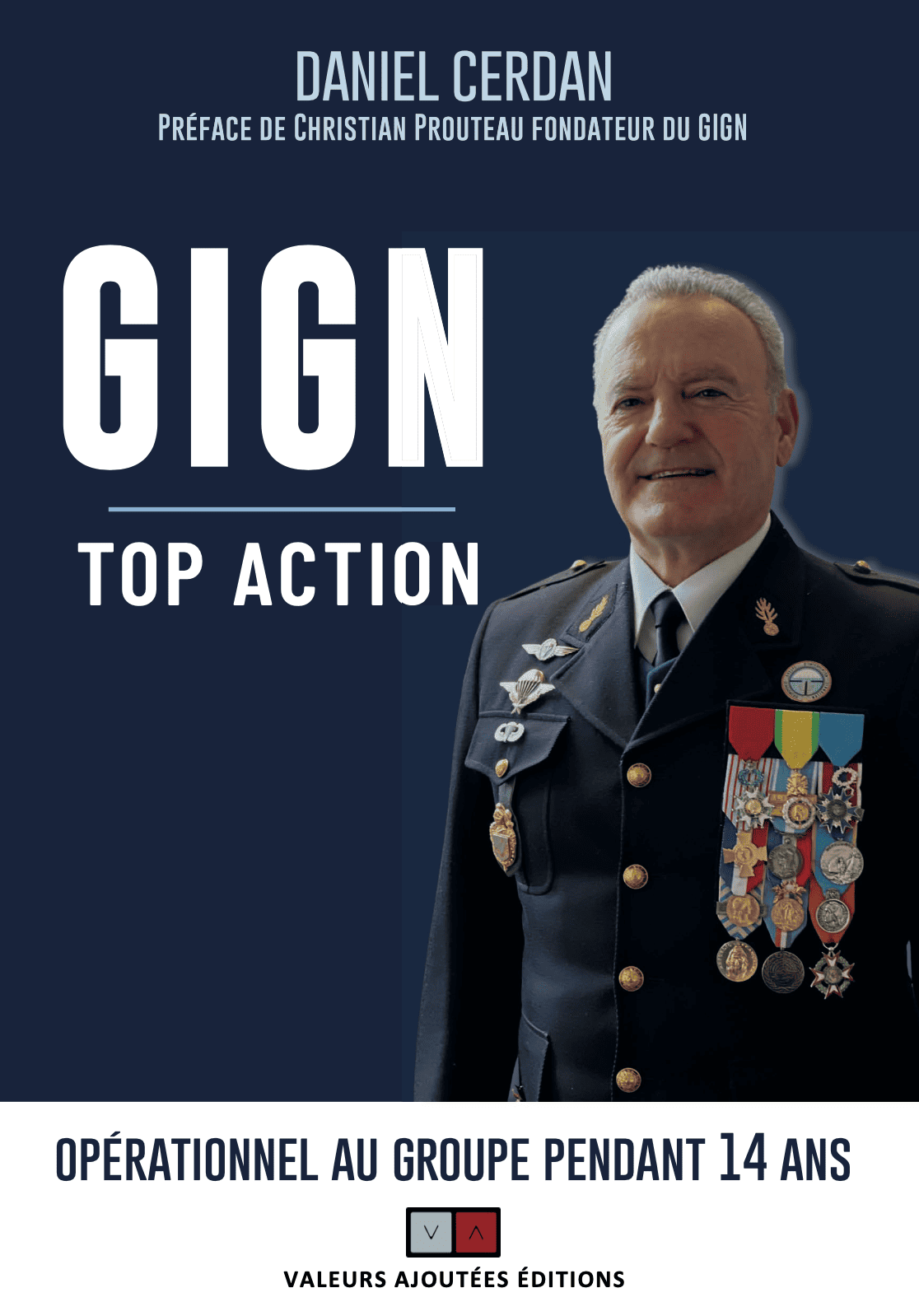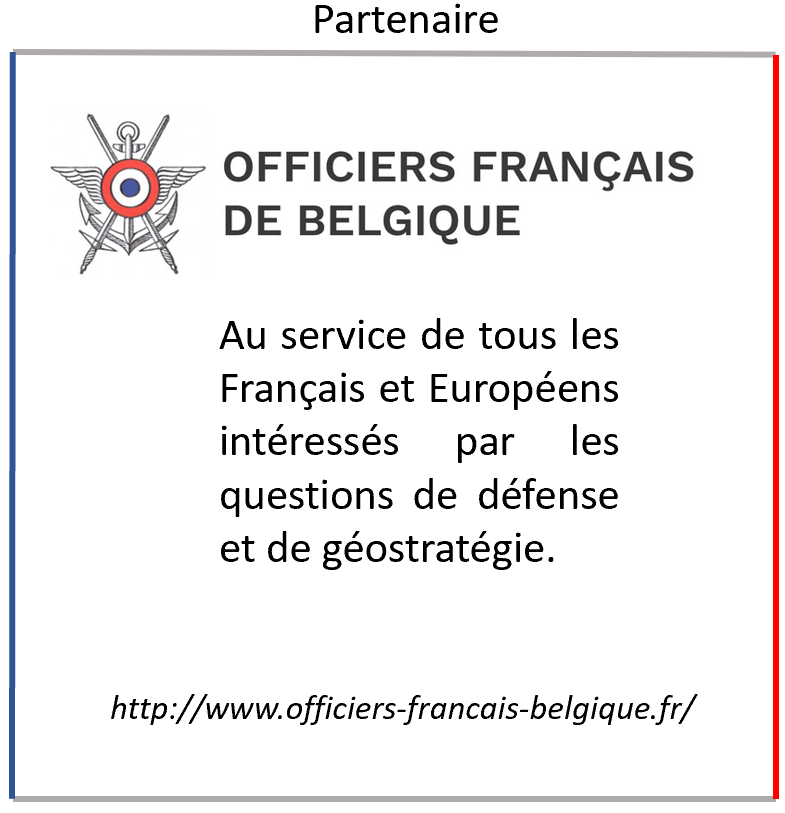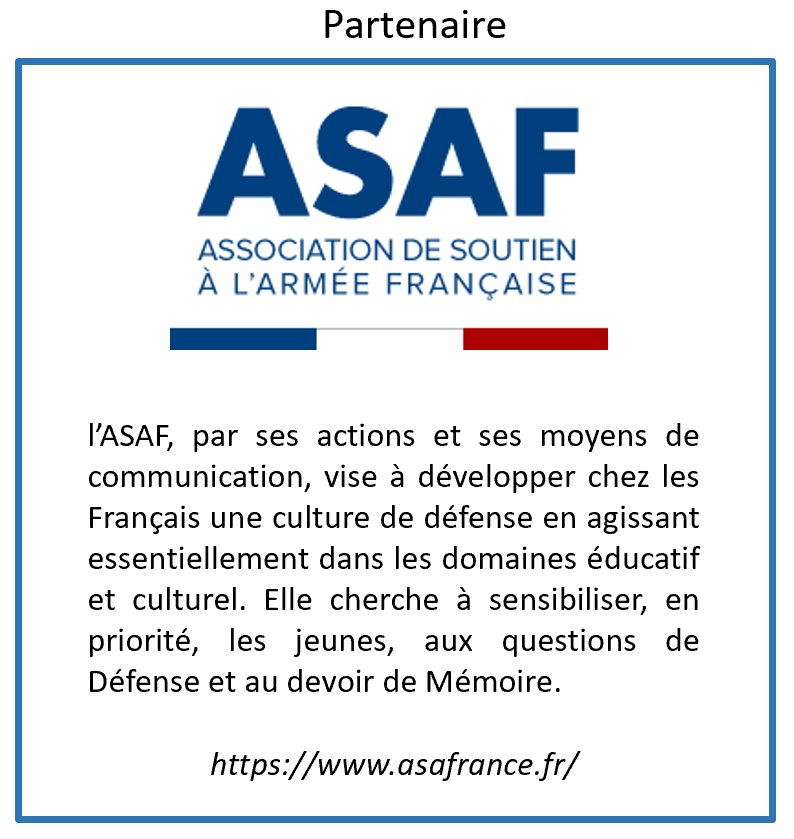La disparition d’un chef fantôme

Wikimédia commons
Lorsque Kaboul tombe en 2001 et que les Taliban s’effondrent, Mollah Mohammad Omar se volatilise. Aucun entretien, aucun message vidéo, aucun déplacement connu : le « Commandeur des croyants » disparaît du champ médiatique comme de la scène militaire. Pendant plus d’une décennie, la CIA, l’ISI pakistanais et la Direction de la sûreté afghane le cherchent sans succès, convaincus tour à tour qu’il se cache dans les zones tribales pakistanaises, à Quetta ou dans les montagnes de Zabul. En réalité, les informations désormais recoupées indiquent qu’il vit en clandestin absolu, sans rôle opérationnel réel, dans un périmètre étonnamment proche du pouvoir afghan. Dès 2012, des responsables talibans reconnaîtront en privé qu’il ne dirige plus rien et que les décisions sont prises par un cercle plus jeune autour d’Akhtar Mansour. Le fondateur du premier Émirat islamique n’est déjà plus qu’un symbole ritualisé, une caution morale utilisée pour maintenir la cohésion interne d’un mouvement traversé par de fortes rivalités.
Une mort secrète révélée trop tard
L’énigme Mollah Omar éclate en 2015, lorsque les services afghans révèlent qu’il est mort depuis deux ans. Selon ces sources, corroborées ultérieurement par des enquêtes journalistiques, Omar serait décédé en avril 2013, probablement de tuberculose, dans un hôpital de Kaboul ou à proximité immédiate de la capitale. Le choc est profond : non seulement le chef taliban ne se trouvait pas au Pakistan, contrairement au récit longtemps entretenu, mais il vivait à quelques kilomètres des forces qu’il combattait, protégé par un cercle restreint qui a réussi l’exploit de cacher son décès au reste du mouvement. La dissimulation sert à éviter une guerre de succession qui aurait pu fragmenter l’insurrection. Pendant plus de vingt-quatre mois, les Talibans diffusent des communiqués et des messages audio présentés comme les siens, alors qu’il n’est déjà plus en vie. Lorsque la mort est finalement officialisée, Akhtar Mansour s’impose comme successeur, mais le mensonge initial alimente une profonde défiance interne et ouvre une période de contestations violentes entre factions.
Un héritage instrumentalisé par l’Émirat islamique
Après 2015, la figure d’Omar cesse d’être celle d’un stratège et devient un mythe politique. Haibatullah Akhundzada, actuel dirigeant suprême, instrumentalise son image pour légitimer son autorité et inscrire le deuxième Émirat islamique dans une continuité pseudo spirituelle. Omar est présenté comme l’archétype du chef pieux, pur, presque ascétique, vivant dans une pauvreté volontaire et refusant toute compromission étrangère. Cette reconstruction posthume gomme pourtant la réalité de sa marginalisation progressive et de son absence totale de rôle après 2001. Dans la mémoire talibane, il demeure néanmoins le fondateur sacralisé, celui qui a porté le manteau du prophète et symbolisé la naissance d’un ordre politico-religieux radical. Son parcours montre une vérité fondamentale du mouvement : sa force ne repose pas sur des chefs visibles mais sur des mythes, des loyautés tribales et une structure d’autorité diffuse. Mollah Omar est devenu une icône morte, utile à tous parce qu’elle ne parle plus, et dont l’ombre sert aujourd’hui de caution à un régime dont il n’a jamais vu la victoire.
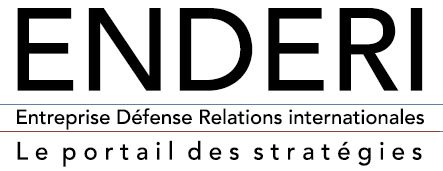
 Diplomatie
Diplomatie