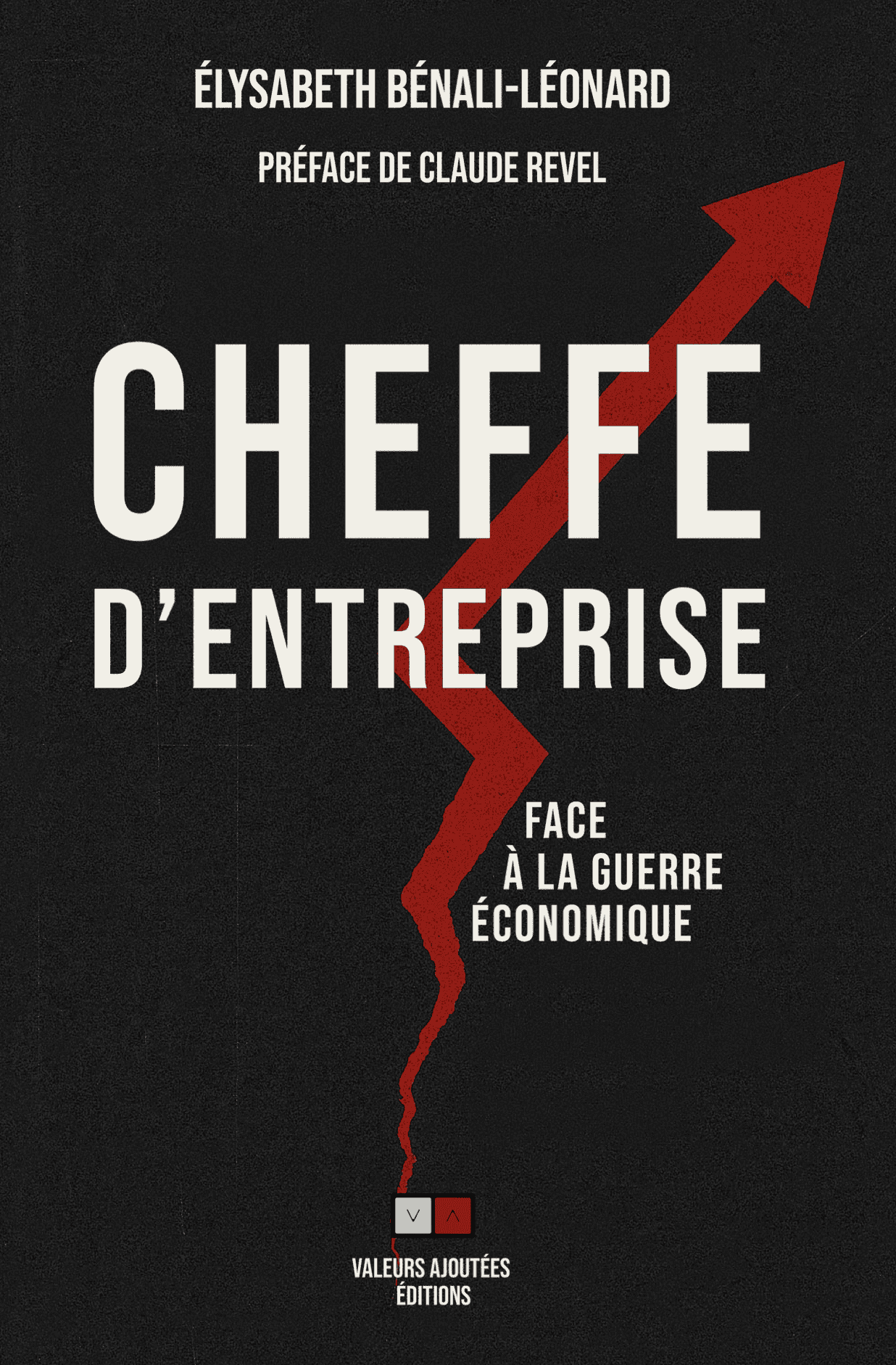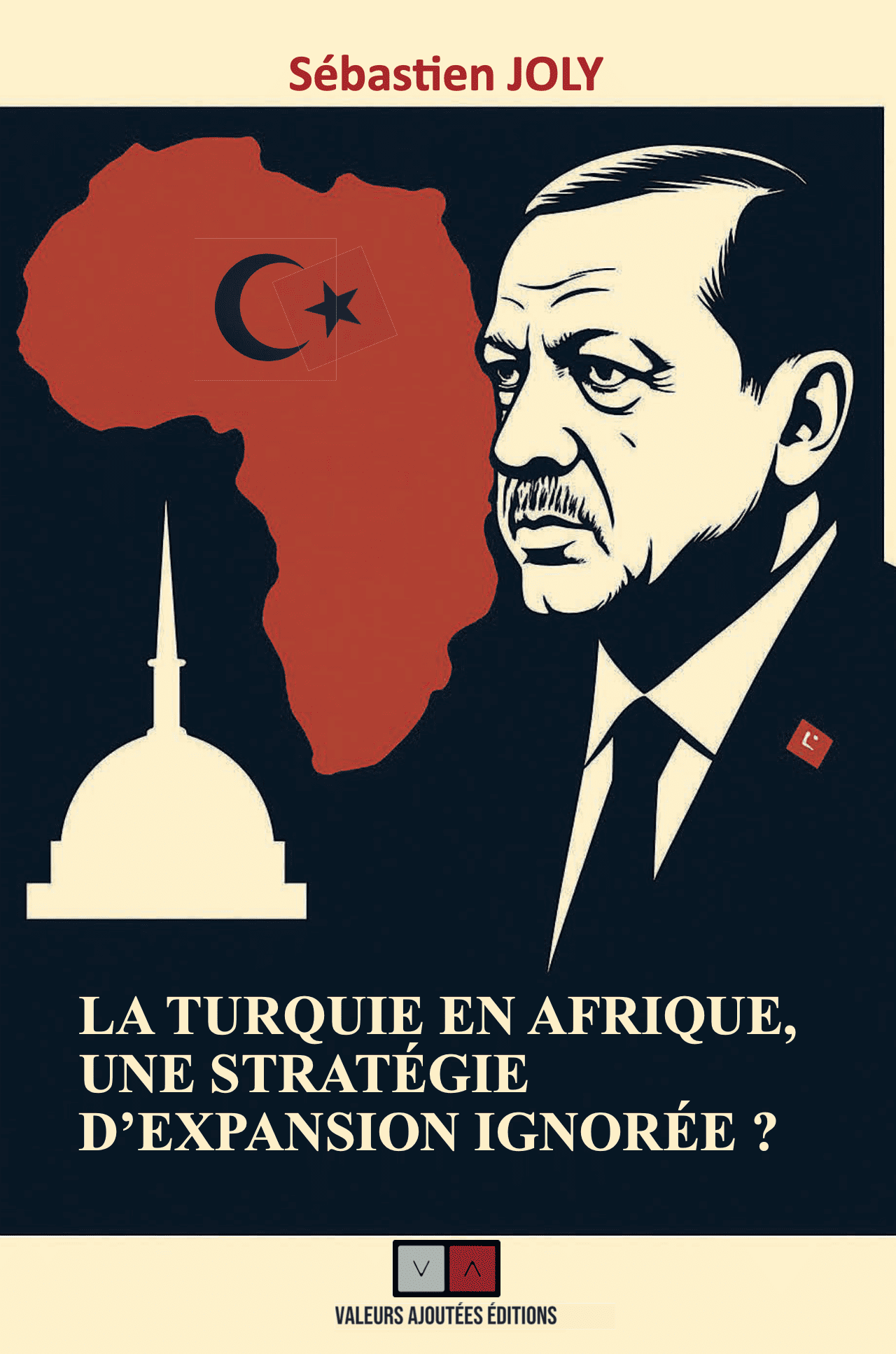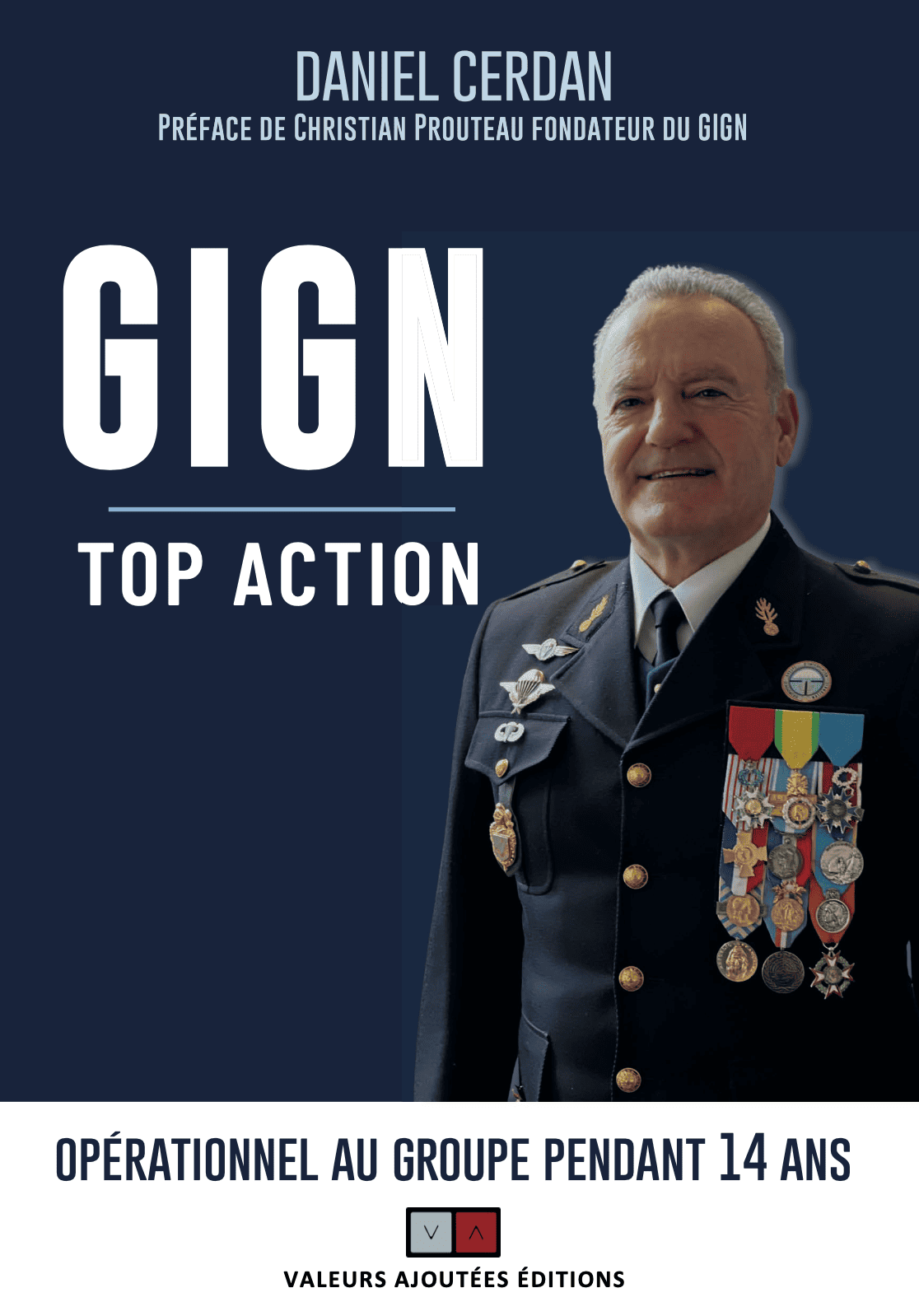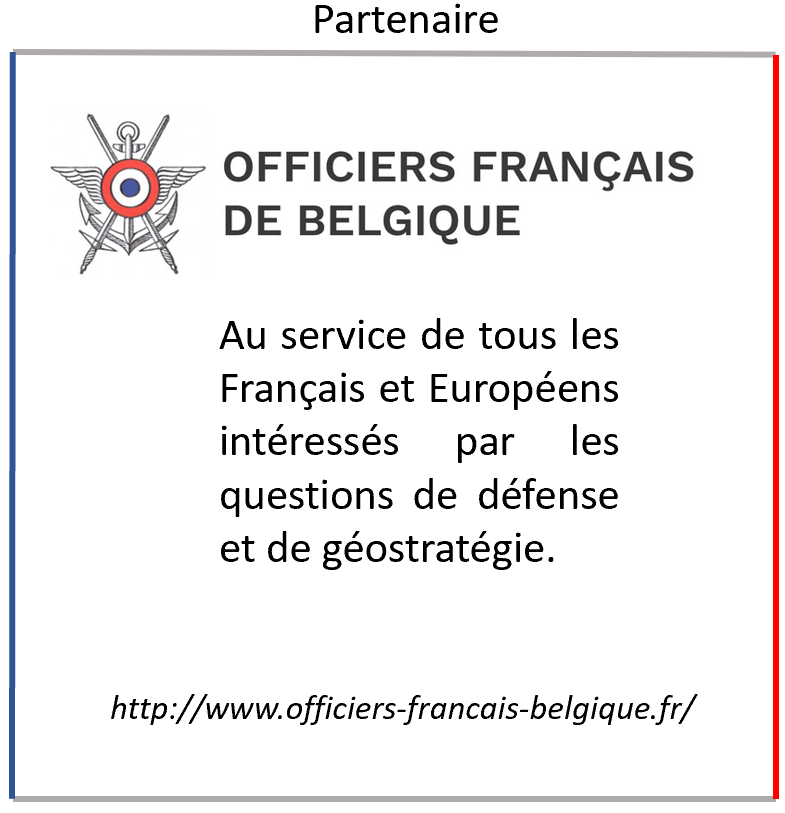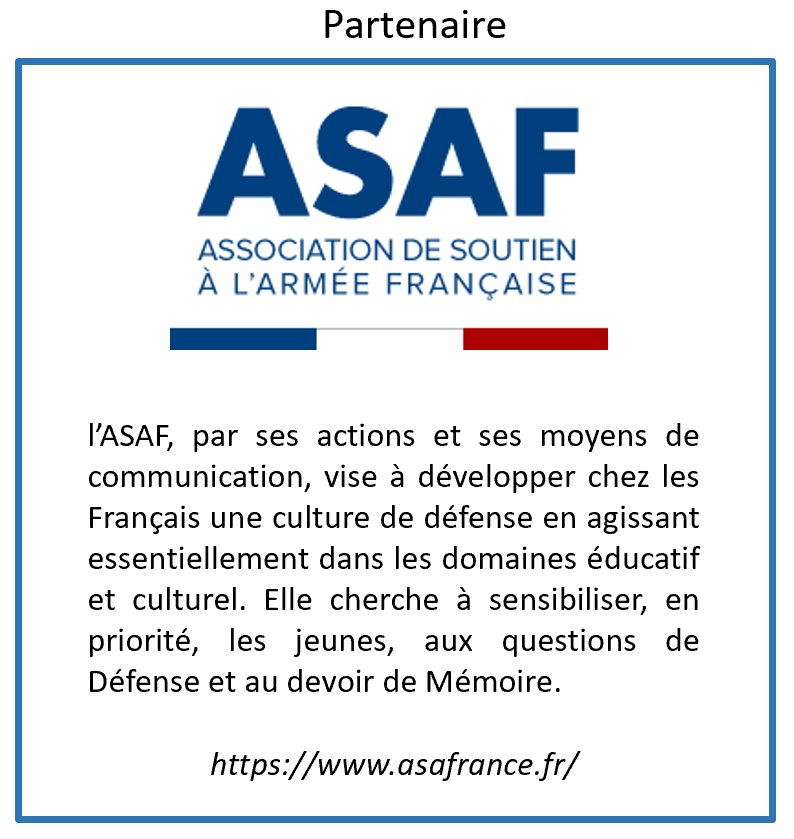Pourquoi l’Indo-Pacifique ?
Car c’est un espace central ; la zone s’étend de la côte est-africaine au Pacifique occidental. Elle y concentre plus de 60 % de la population mondiale et près de 40 % du PIB mondial (OCDE, 2023). Mais c’est aussi un carrefour économique : près d’un tiers du commerce maritime mondial transite par la mer de Chine méridionale, dont les détroits de Malacca et de Lombok. Dès lors, elle est source d’intérêts pour les pays voisins. Pékin revendique une grande partie de ces mers via sa « nine-dash line », construit des bases artificielles militarisées et accroît sa flotte, devenue la plus importante au monde en tonnage (US DoD, China Military Power Report 2023).
Ces revendications tendent à modifier le paysage géopolitique local. Et l’expansion chinoise nécessite une réponse occidentale.
La réponse occidentale : multiplication des alliances
AUKUS : un pacte technologique et militaire
Signé en septembre 2021 par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, l’accord AUKUS prévoit le transfert à Canberra de sous-marins à propulsion nucléaire, technologie jusque-là partagée uniquement entre Washington et Londres. Il inclut aussi une coopération avancée en cybersécurité, IA, drones et guerre sous-marine. Ainsi, la première livraison est prévue vers 2030-2035, avec un coût estimé à 368 milliards AUD sur 30 ans.
Le QUAD : une alliance « informelle »
Créé en 2007et réactivée en 2017, le Quadrilateral Security Dialogue réunit les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Son objectif est de promouvoir un « Indo-Pacifique libre et ouvert » face à l’expansion chinoise. Cette coopération est évidement portée sur la défense, mais aussi sur les chaînes d’approvisionnement, la 5G, la cybersécurité et les vaccins.
Des partenariats européens émergents
Seule puissance européenne présente militairement dans la zone (forces à Djibouti, Nouvelle-Calédonie, Polynésie), la France promeut une stratégie « Indo-Pacifique inclusive » portée sur les enjeux militaires et économiques dans la région.
L’Union Européenne a quant à elle adopté une stratégie sur l’Indo-Pacifique en 2021, focalisée sur la résilience économique et la sécurité maritime. Ainsi, on verra l’Allemagne envoyer des frégates en mer de Chine méridionale en 2021-2022, marquant une implication symbolique.
Les réactions chinoises et régionales
Pékin : dénonciation d’un « OTAN de l’Asie »
La Chine considère AUKUS et le Quad comme des instruments d’endiguement. Pékin dénonce le transfert de sous-marins nucléaires comme une violation du Traité de non-prolifération (TNP), bien que les co-signataires affirment le contraire.
Les États du Sud-Est asiatique : prudence stratégique
Les membres de l’ASEAN évitent de choisir leur camp. Singapour et le Vietnam coopèrent étroitement avec Washington, mais restent prudents. L’Indonésie exprime régulièrement ses inquiétudes face à la prolifération nucléaire régionale.
Une montée en puissance… mais à double tranchant
En cherchant une stabilisation relative, les alliances envoient un signal de dissuasion à Pékin, réduisant le risque d’actions unilatérales. Mais ce positionnement implique une course aux armements et les budgets explosent : l’Australie consacre déjà 2,1 % de son PIB à la défense, et le Japon a annoncé un plan de 320 milliards USD sur 5 ans pour devenir la troisième puissance militaire mondiale.
Conclusion
L’Indo-Pacifique est le laboratoire d’une nouvelle guerre froide : d’un côté, une Chine qui consolide sa puissance maritime et revendique son espace vital ; de l’autre, un bloc occidental et allié qui tente de contenir cette expansion par une dissuasion collective.
Mais ces alliances posent deux questions :
Car c’est un espace central ; la zone s’étend de la côte est-africaine au Pacifique occidental. Elle y concentre plus de 60 % de la population mondiale et près de 40 % du PIB mondial (OCDE, 2023). Mais c’est aussi un carrefour économique : près d’un tiers du commerce maritime mondial transite par la mer de Chine méridionale, dont les détroits de Malacca et de Lombok. Dès lors, elle est source d’intérêts pour les pays voisins. Pékin revendique une grande partie de ces mers via sa « nine-dash line », construit des bases artificielles militarisées et accroît sa flotte, devenue la plus importante au monde en tonnage (US DoD, China Military Power Report 2023).
Ces revendications tendent à modifier le paysage géopolitique local. Et l’expansion chinoise nécessite une réponse occidentale.
La réponse occidentale : multiplication des alliances
AUKUS : un pacte technologique et militaire
Signé en septembre 2021 par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, l’accord AUKUS prévoit le transfert à Canberra de sous-marins à propulsion nucléaire, technologie jusque-là partagée uniquement entre Washington et Londres. Il inclut aussi une coopération avancée en cybersécurité, IA, drones et guerre sous-marine. Ainsi, la première livraison est prévue vers 2030-2035, avec un coût estimé à 368 milliards AUD sur 30 ans.
Le QUAD : une alliance « informelle »
Créé en 2007et réactivée en 2017, le Quadrilateral Security Dialogue réunit les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Son objectif est de promouvoir un « Indo-Pacifique libre et ouvert » face à l’expansion chinoise. Cette coopération est évidement portée sur la défense, mais aussi sur les chaînes d’approvisionnement, la 5G, la cybersécurité et les vaccins.
Des partenariats européens émergents
Seule puissance européenne présente militairement dans la zone (forces à Djibouti, Nouvelle-Calédonie, Polynésie), la France promeut une stratégie « Indo-Pacifique inclusive » portée sur les enjeux militaires et économiques dans la région.
L’Union Européenne a quant à elle adopté une stratégie sur l’Indo-Pacifique en 2021, focalisée sur la résilience économique et la sécurité maritime. Ainsi, on verra l’Allemagne envoyer des frégates en mer de Chine méridionale en 2021-2022, marquant une implication symbolique.
Les réactions chinoises et régionales
Pékin : dénonciation d’un « OTAN de l’Asie »
La Chine considère AUKUS et le Quad comme des instruments d’endiguement. Pékin dénonce le transfert de sous-marins nucléaires comme une violation du Traité de non-prolifération (TNP), bien que les co-signataires affirment le contraire.
Les États du Sud-Est asiatique : prudence stratégique
Les membres de l’ASEAN évitent de choisir leur camp. Singapour et le Vietnam coopèrent étroitement avec Washington, mais restent prudents. L’Indonésie exprime régulièrement ses inquiétudes face à la prolifération nucléaire régionale.
Une montée en puissance… mais à double tranchant
En cherchant une stabilisation relative, les alliances envoient un signal de dissuasion à Pékin, réduisant le risque d’actions unilatérales. Mais ce positionnement implique une course aux armements et les budgets explosent : l’Australie consacre déjà 2,1 % de son PIB à la défense, et le Japon a annoncé un plan de 320 milliards USD sur 5 ans pour devenir la troisième puissance militaire mondiale.
Conclusion
L’Indo-Pacifique est le laboratoire d’une nouvelle guerre froide : d’un côté, une Chine qui consolide sa puissance maritime et revendique son espace vital ; de l’autre, un bloc occidental et allié qui tente de contenir cette expansion par une dissuasion collective.
Mais ces alliances posent deux questions :
- Jusqu’où les États sont-ils prêts à aller pour défendre un « ordre libre et ouvert » face à Pékin ?
- Ne risquent-ils pas de provoquer eux-mêmes l’escalade qu’ils prétendent éviter ?
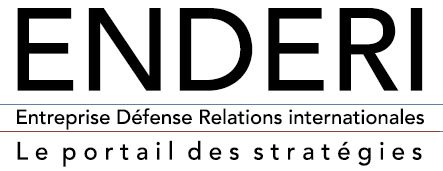
 Diplomatie
Diplomatie