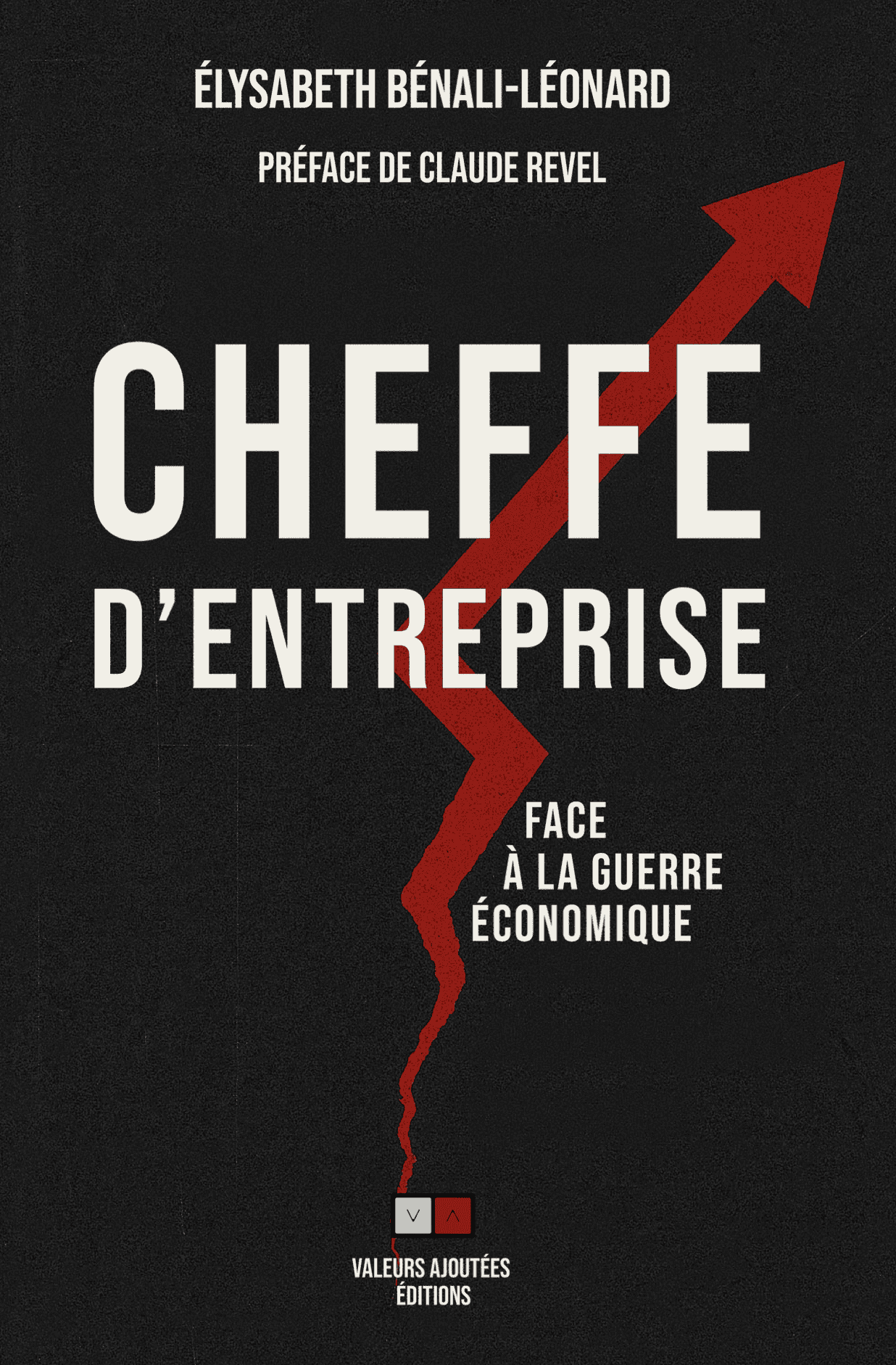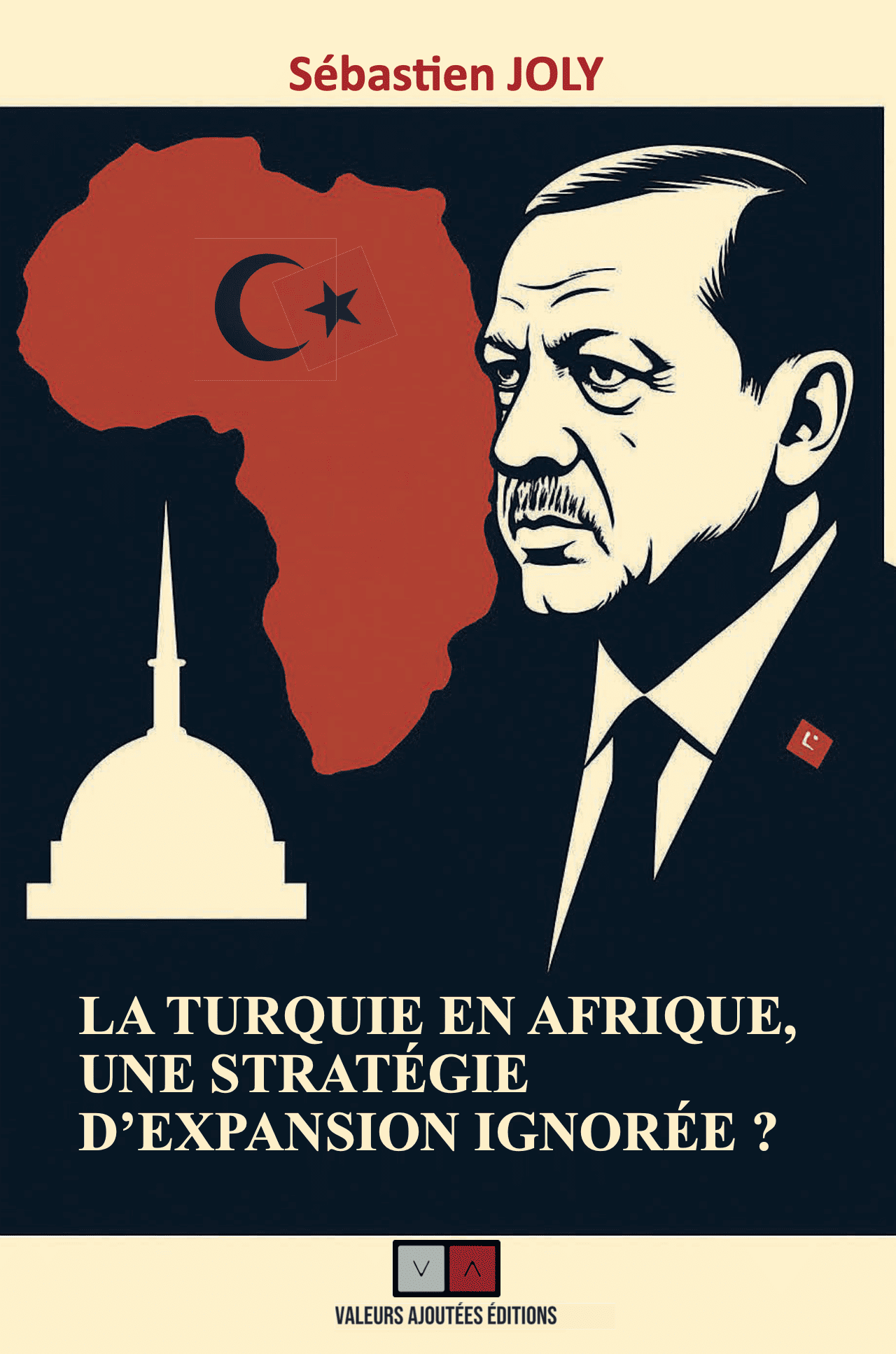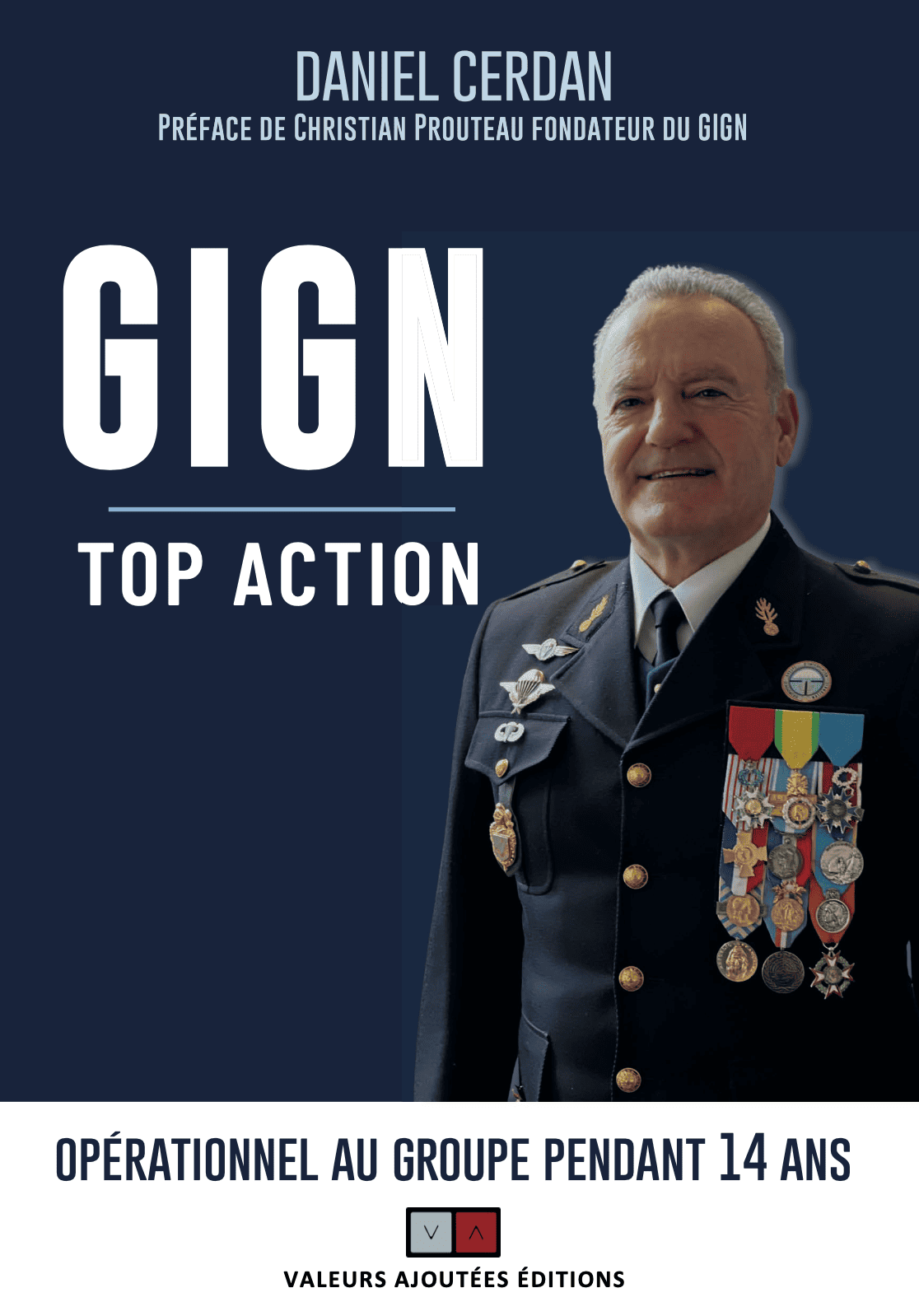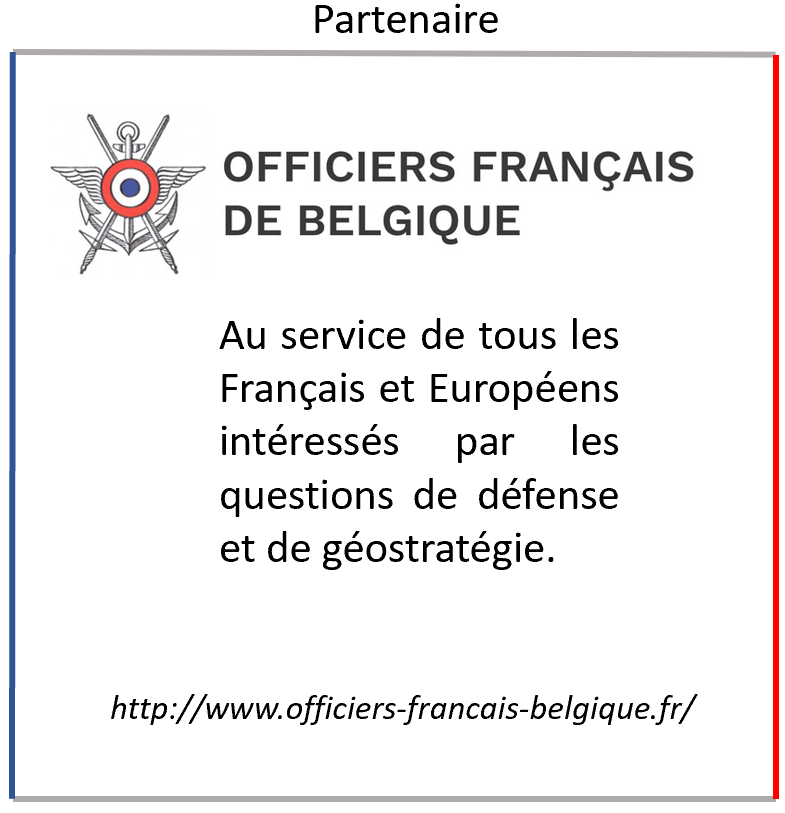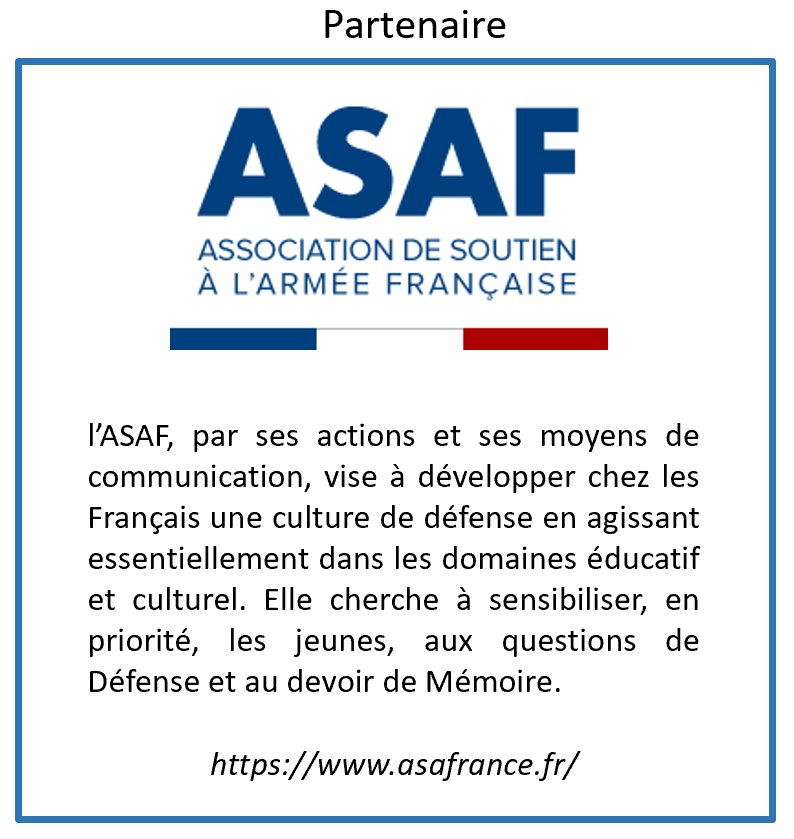L’actualité internationale semble n’être qu’un enchaînement de crises, de guerres et de basculements rapides. Pourtant, si l’on prend un peu de recul, on observe que les nations rejouent souvent les mêmes scénarios. Les acteurs changent, les régimes passent, mais les logiques profondes demeurent. C’est ce que l’on appelle les permanences historiques : ces invariants nés de la géographie, de la mémoire collective et de l’imaginaire stratégique, qui continuent de structurer le comportement des grandes puissances.
Ainsi, la guerre en Ukraine ne peut se comprendre sans revenir à l’obsession russe de sécuriser ses frontières ; le Brexit, sans rappeler l’insularité britannique ; ou encore l’ascension de la Chine, sans évoquer le retour de « l’Empire du Milieu » à une centralité mondiale qu’il estime naturelle. De Mackinder à la doctrine Monroe, en passant par l’équilibre français et la vulnérabilité allemande, ces permanences éclairent le présent autant qu’elles dessinent l’avenir.
Le Heartland : verrouiller le « pivot géographique de l’histoire »
En 1904, le géographe britannique Halford John Mackinder présente à la Royal Geographical Society un article resté célèbre : The Geographical Pivot of History. Il y expose une thèse simple mais décisive : la puissance mondiale se joue dans le contrôle du Heartland, ce vaste espace eurasien allant de la Volga à la Sibérie, du Caucase à l’Arctique. Protégé par des obstacles naturels, difficile d’accès aux marines occidentales, cet espace est le cœur terrestre de la planète. Mackinder formule alors sa maxime :
« Qui domine l’Europe de l’Est domine le Heartland ;
Qui domine le Heartland domine l’Île-monde ;
Qui domine l’Île-monde domine le monde. »
Pour Londres, puissance maritime, cette réflexion sonne comme un avertissement : empêcher à tout prix qu’une puissance continentale – d’abord l’Allemagne, puis l’URSS, aujourd’hui la Russie – ne verrouille ce pivot. Les guerres mondiales, la guerre froide, puis la stratégie d’élargissement de l’OTAN peuvent toutes se lire à travers cette permanence. L’Ukraine, aujourd’hui, en est une illustration brûlante : pour Washington comme pour Londres, empêcher Moscou de reconstituer une zone d’influence en Europe de l’Est reste un impératif géopolitique hérité de Mackinder.
Le monde anglo-saxon : de l’insularité à la domination maritime
La Grande-Bretagne a longtemps cultivé une singularité stratégique : protégée par la mer, elle a fait de l’insularité une arme. Sa priorité n’était pas la conquête du continent, mais l’empêchement qu’une puissance européenne (Espagne, France, Allemagne) ne devienne hégémonique. C’est le fameux principe de balance of power : s’allier avec le plus faible pour contrebalancer le plus fort.
Cette insularité a poussé Londres vers la mer. La Royal Navy est devenue l’outil d’une projection mondiale, au service du commerce, de l’empire et du contrôle des routes maritimes. Cette logique a conduit à la constitution d’un empire où « le soleil ne se couchait jamais ».
Toutefois, les permanences ne sont pas des déterminismes. Comme l'écrivait Raphaël Chauvancy dans Les nouveaux visages de la guerre : "On a beaucoup glosé sur le génie stratégique de l'Angleterre. Il tient en quelques mots. C'est de réserver ses forces. Protégés par leur insularité, les Britanniques ont rarement eu à déployer toutes leurs ressources à la fois. Leur empire ne s'est paradoxalement pas constitué par projections de forces, mais par abstention. Pendant que leurs rivaux européens dilapidaient leur or en canons, se décimaient les uns les autres et se rasaient des places fortes, Londres investissait dans de bons navires propres au commerce autant qu'à la guerre. Quand un rival prétendait lui en remontrer sur les flots, on lui suscitait une guerre continentale où il s'épuisait." p. 117
Les États-Unis, héritiers de cette tradition, ont adopté leur propre permanence historique. D’abord repliés sur eux-mêmes, ils ont énoncé dès 1823 la doctrine Monroe : pas d’ingérence européenne dans les affaires américaines. Puis, forts de leur position géographique unique – deux océans protecteurs, pas de voisin menaçant –, ils ont basculé vers une stratégie globale : contrôle des mers, protection des échanges, endiguement des puissances continentales. Aujourd’hui encore, le « monde libre » organisé par Washington repose sur cette permanence : la liberté des mers comme fondement de la puissance.
La France : carrefour et puissance d’équilibre
La France, à l’inverse, n’est pas une île. C'est une puissance de la terre. Elle est un carrefour : entre monde latin et germanique, entre Atlantique et Méditerranée, entre Europe du Nord et Sud. Cette situation géographique a façonné son histoire : défendre des frontières multiples, souvent disputées (Flandres, Alsace, Alpes, Pyrénées), a conduit à un État centralisé, obsédé par la sécurité du territoire. Mais la France ne s’est pas contentée de défendre ses frontières. Elle a toujours voulu projeter une influence au-delà de son espace. La Révolution puis l’Empire ont nourri une vocation universaliste : exporter des idées, porter un message au-delà de ses intérêts immédiats. Cette permanence se retrouve aujourd’hui dans la quête d’« indépendance stratégique » et dans la diplomatie française, toujours soucieuse d’équilibrer les grandes puissances, d’offrir une « troisième voie » entre blocs, ou de défendre une vision universelle (droits de l’homme, multilatéralisme). La centralité géographique et la vocation universaliste constituent deux faces d’une même permanence : la France comme puissance d’équilibre.
L’Allemagne : vulnérabilité et tentation de la Mitteleuropa
L’Allemagne se caractérise par une vulnérabilité géographique : un espace ouvert, sans frontières naturelles solides, exposé aux invasions venues de l’Est comme de l’Ouest. Cette situation a alimenté une hantise de l’encerclement et une quête de profondeur stratégique. Au XIXe et XXe siècles, cela s’est traduit par deux tendances lourdes : le Drang nach Osten (poussée vers l’Est, vers la Pologne et au-delà) et le Lebensraum (espace vital). Ces permanences se sont muées en catastrophes au XXe siècle avec les deux guerres mondiales. Aujourd’hui, l’Allemagne, réinsérée dans l’Union européenne, a transformé cette permanence en une logique d’intégration économique et de recherche de débouchés à l’Est. Sa dépendance au gaz russe avant 2022 illustrait encore cette continuité : sécuriser son approvisionnement et son espace vital par l’ouverture vers l’Est. Même « pacifiée », la permanence allemande – vulnérabilité et besoin d’intégration – continue de structurer sa place en Europe.
La Chine : le retour au centre du monde
La Chine se définit par une permanence différente : se penser comme le centre. Le terme même d’« Empire du Milieu » exprime cette conviction. Historiquement, l’empire chinois a vécu dans un monde hiérarchisé, où les périphéries reconnaissaient la supériorité culturelle du centre. Le XIXe siècle a brisé cette illusion : guerres de l’opium, invasions étrangères, « siècle des humiliations ». Ce traumatisme est devenu le moteur d’un retour : restaurer la grandeur perdue, effacer l’humiliation. Aujourd’hui, cette permanence se traduit par une double stratégie :
Continentale, avec la Belt and Road Initiative (Nouvelles Routes de la Soie), qui recrée un réseau d’influence en Eurasie, rappelant les routes anciennes.
Maritime, avec l’affirmation en mer de Chine méridionale, pour rompre l’encerclement américain et retrouver une projection mondiale.
La permanence chinoise est donc celle du retour au centre, une réactualisation du rôle impérial à l’ère de la mondialisation.
Derrière les bouleversements du présent, les permanences historiques révèlent la profondeur de la géopolitique. L’obsession russe du Heartland, l’insularité anglo-saxonne, la centralité française, la vulnérabilité allemande, le retour chinois : autant de trames anciennes qui se rejouent aujourd’hui sous des formes nouvelles. La mondialisation et les interdépendances n’ont pas aboli ces permanences. Elles les habillent autrement, mais elles ne les effacent pas. Mais bien crédule celui qui se fierait uniquement à cette grille de lecture. L'histoire et la mémoire forgés par l'imaginaire collectif peuvent nous aider à comprendre les dynamiques géopolitiques. En aucun cas elles nous permettent de devancer les prises de positions. Aucun système ne régit le monde dans son entièreté et la complexité des cultures nous contraint à envisager l'imprévu.
Ainsi, la guerre en Ukraine ne peut se comprendre sans revenir à l’obsession russe de sécuriser ses frontières ; le Brexit, sans rappeler l’insularité britannique ; ou encore l’ascension de la Chine, sans évoquer le retour de « l’Empire du Milieu » à une centralité mondiale qu’il estime naturelle. De Mackinder à la doctrine Monroe, en passant par l’équilibre français et la vulnérabilité allemande, ces permanences éclairent le présent autant qu’elles dessinent l’avenir.
Le Heartland : verrouiller le « pivot géographique de l’histoire »
En 1904, le géographe britannique Halford John Mackinder présente à la Royal Geographical Society un article resté célèbre : The Geographical Pivot of History. Il y expose une thèse simple mais décisive : la puissance mondiale se joue dans le contrôle du Heartland, ce vaste espace eurasien allant de la Volga à la Sibérie, du Caucase à l’Arctique. Protégé par des obstacles naturels, difficile d’accès aux marines occidentales, cet espace est le cœur terrestre de la planète. Mackinder formule alors sa maxime :
« Qui domine l’Europe de l’Est domine le Heartland ;
Qui domine le Heartland domine l’Île-monde ;
Qui domine l’Île-monde domine le monde. »
Pour Londres, puissance maritime, cette réflexion sonne comme un avertissement : empêcher à tout prix qu’une puissance continentale – d’abord l’Allemagne, puis l’URSS, aujourd’hui la Russie – ne verrouille ce pivot. Les guerres mondiales, la guerre froide, puis la stratégie d’élargissement de l’OTAN peuvent toutes se lire à travers cette permanence. L’Ukraine, aujourd’hui, en est une illustration brûlante : pour Washington comme pour Londres, empêcher Moscou de reconstituer une zone d’influence en Europe de l’Est reste un impératif géopolitique hérité de Mackinder.
Le monde anglo-saxon : de l’insularité à la domination maritime
La Grande-Bretagne a longtemps cultivé une singularité stratégique : protégée par la mer, elle a fait de l’insularité une arme. Sa priorité n’était pas la conquête du continent, mais l’empêchement qu’une puissance européenne (Espagne, France, Allemagne) ne devienne hégémonique. C’est le fameux principe de balance of power : s’allier avec le plus faible pour contrebalancer le plus fort.
Cette insularité a poussé Londres vers la mer. La Royal Navy est devenue l’outil d’une projection mondiale, au service du commerce, de l’empire et du contrôle des routes maritimes. Cette logique a conduit à la constitution d’un empire où « le soleil ne se couchait jamais ».
Toutefois, les permanences ne sont pas des déterminismes. Comme l'écrivait Raphaël Chauvancy dans Les nouveaux visages de la guerre : "On a beaucoup glosé sur le génie stratégique de l'Angleterre. Il tient en quelques mots. C'est de réserver ses forces. Protégés par leur insularité, les Britanniques ont rarement eu à déployer toutes leurs ressources à la fois. Leur empire ne s'est paradoxalement pas constitué par projections de forces, mais par abstention. Pendant que leurs rivaux européens dilapidaient leur or en canons, se décimaient les uns les autres et se rasaient des places fortes, Londres investissait dans de bons navires propres au commerce autant qu'à la guerre. Quand un rival prétendait lui en remontrer sur les flots, on lui suscitait une guerre continentale où il s'épuisait." p. 117
Les États-Unis, héritiers de cette tradition, ont adopté leur propre permanence historique. D’abord repliés sur eux-mêmes, ils ont énoncé dès 1823 la doctrine Monroe : pas d’ingérence européenne dans les affaires américaines. Puis, forts de leur position géographique unique – deux océans protecteurs, pas de voisin menaçant –, ils ont basculé vers une stratégie globale : contrôle des mers, protection des échanges, endiguement des puissances continentales. Aujourd’hui encore, le « monde libre » organisé par Washington repose sur cette permanence : la liberté des mers comme fondement de la puissance.
La France : carrefour et puissance d’équilibre
La France, à l’inverse, n’est pas une île. C'est une puissance de la terre. Elle est un carrefour : entre monde latin et germanique, entre Atlantique et Méditerranée, entre Europe du Nord et Sud. Cette situation géographique a façonné son histoire : défendre des frontières multiples, souvent disputées (Flandres, Alsace, Alpes, Pyrénées), a conduit à un État centralisé, obsédé par la sécurité du territoire. Mais la France ne s’est pas contentée de défendre ses frontières. Elle a toujours voulu projeter une influence au-delà de son espace. La Révolution puis l’Empire ont nourri une vocation universaliste : exporter des idées, porter un message au-delà de ses intérêts immédiats. Cette permanence se retrouve aujourd’hui dans la quête d’« indépendance stratégique » et dans la diplomatie française, toujours soucieuse d’équilibrer les grandes puissances, d’offrir une « troisième voie » entre blocs, ou de défendre une vision universelle (droits de l’homme, multilatéralisme). La centralité géographique et la vocation universaliste constituent deux faces d’une même permanence : la France comme puissance d’équilibre.
L’Allemagne : vulnérabilité et tentation de la Mitteleuropa
L’Allemagne se caractérise par une vulnérabilité géographique : un espace ouvert, sans frontières naturelles solides, exposé aux invasions venues de l’Est comme de l’Ouest. Cette situation a alimenté une hantise de l’encerclement et une quête de profondeur stratégique. Au XIXe et XXe siècles, cela s’est traduit par deux tendances lourdes : le Drang nach Osten (poussée vers l’Est, vers la Pologne et au-delà) et le Lebensraum (espace vital). Ces permanences se sont muées en catastrophes au XXe siècle avec les deux guerres mondiales. Aujourd’hui, l’Allemagne, réinsérée dans l’Union européenne, a transformé cette permanence en une logique d’intégration économique et de recherche de débouchés à l’Est. Sa dépendance au gaz russe avant 2022 illustrait encore cette continuité : sécuriser son approvisionnement et son espace vital par l’ouverture vers l’Est. Même « pacifiée », la permanence allemande – vulnérabilité et besoin d’intégration – continue de structurer sa place en Europe.
La Chine : le retour au centre du monde
La Chine se définit par une permanence différente : se penser comme le centre. Le terme même d’« Empire du Milieu » exprime cette conviction. Historiquement, l’empire chinois a vécu dans un monde hiérarchisé, où les périphéries reconnaissaient la supériorité culturelle du centre. Le XIXe siècle a brisé cette illusion : guerres de l’opium, invasions étrangères, « siècle des humiliations ». Ce traumatisme est devenu le moteur d’un retour : restaurer la grandeur perdue, effacer l’humiliation. Aujourd’hui, cette permanence se traduit par une double stratégie :
Continentale, avec la Belt and Road Initiative (Nouvelles Routes de la Soie), qui recrée un réseau d’influence en Eurasie, rappelant les routes anciennes.
Maritime, avec l’affirmation en mer de Chine méridionale, pour rompre l’encerclement américain et retrouver une projection mondiale.
La permanence chinoise est donc celle du retour au centre, une réactualisation du rôle impérial à l’ère de la mondialisation.
Derrière les bouleversements du présent, les permanences historiques révèlent la profondeur de la géopolitique. L’obsession russe du Heartland, l’insularité anglo-saxonne, la centralité française, la vulnérabilité allemande, le retour chinois : autant de trames anciennes qui se rejouent aujourd’hui sous des formes nouvelles. La mondialisation et les interdépendances n’ont pas aboli ces permanences. Elles les habillent autrement, mais elles ne les effacent pas. Mais bien crédule celui qui se fierait uniquement à cette grille de lecture. L'histoire et la mémoire forgés par l'imaginaire collectif peuvent nous aider à comprendre les dynamiques géopolitiques. En aucun cas elles nous permettent de devancer les prises de positions. Aucun système ne régit le monde dans son entièreté et la complexité des cultures nous contraint à envisager l'imprévu.
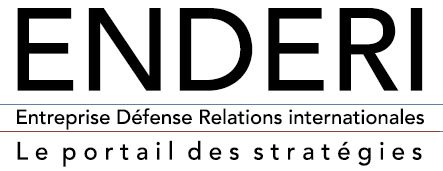
 Diplomatie
Diplomatie