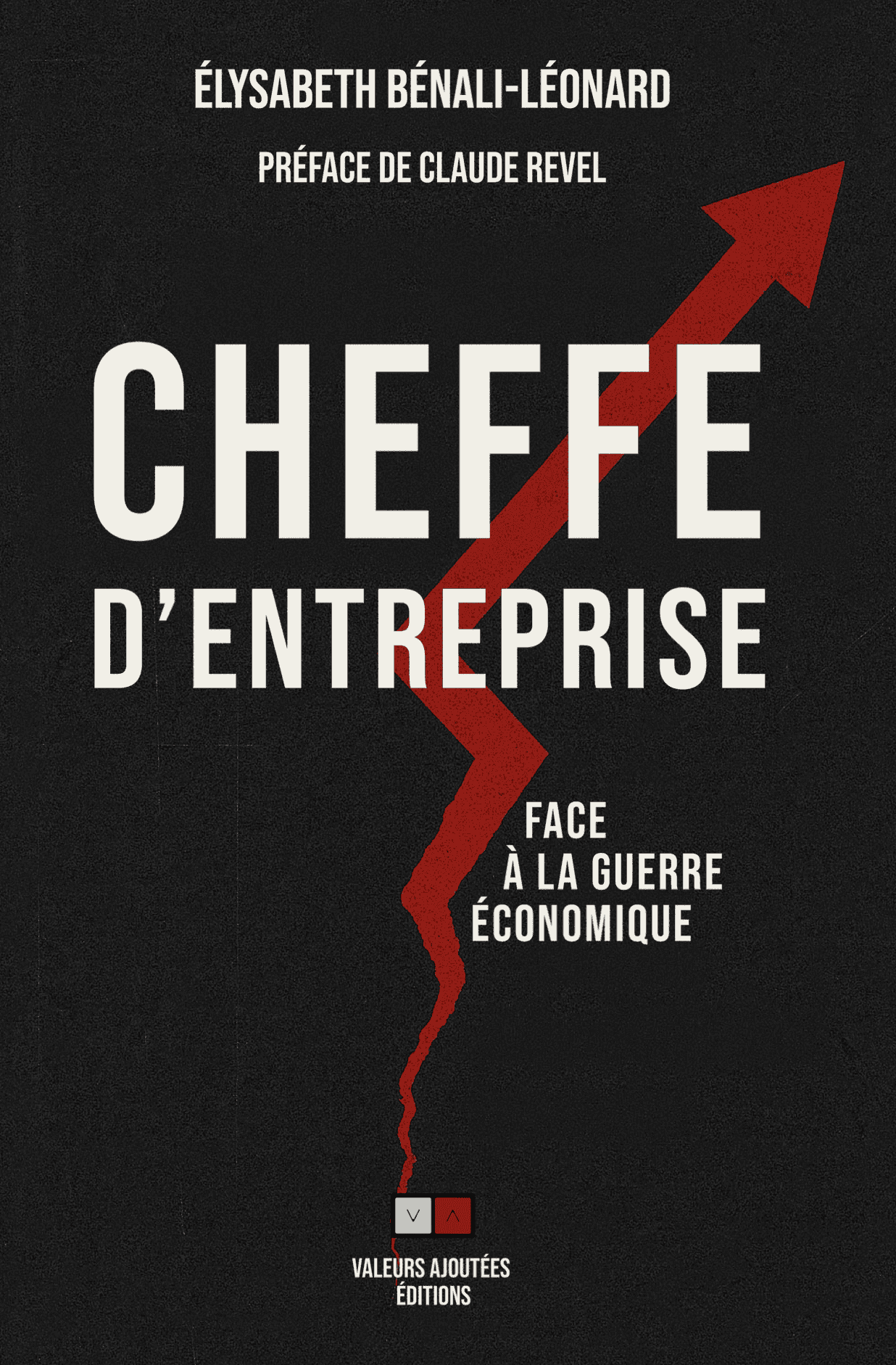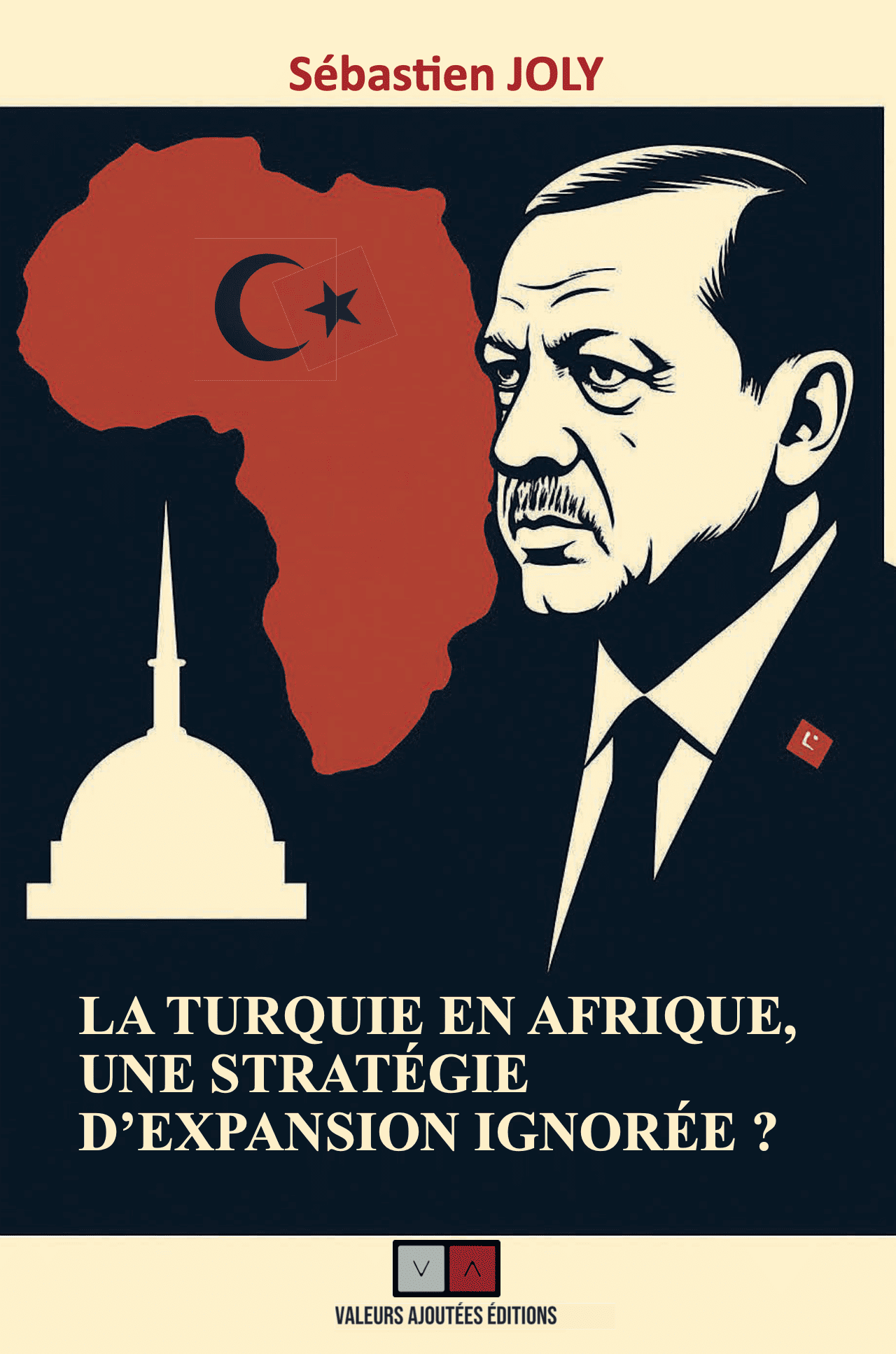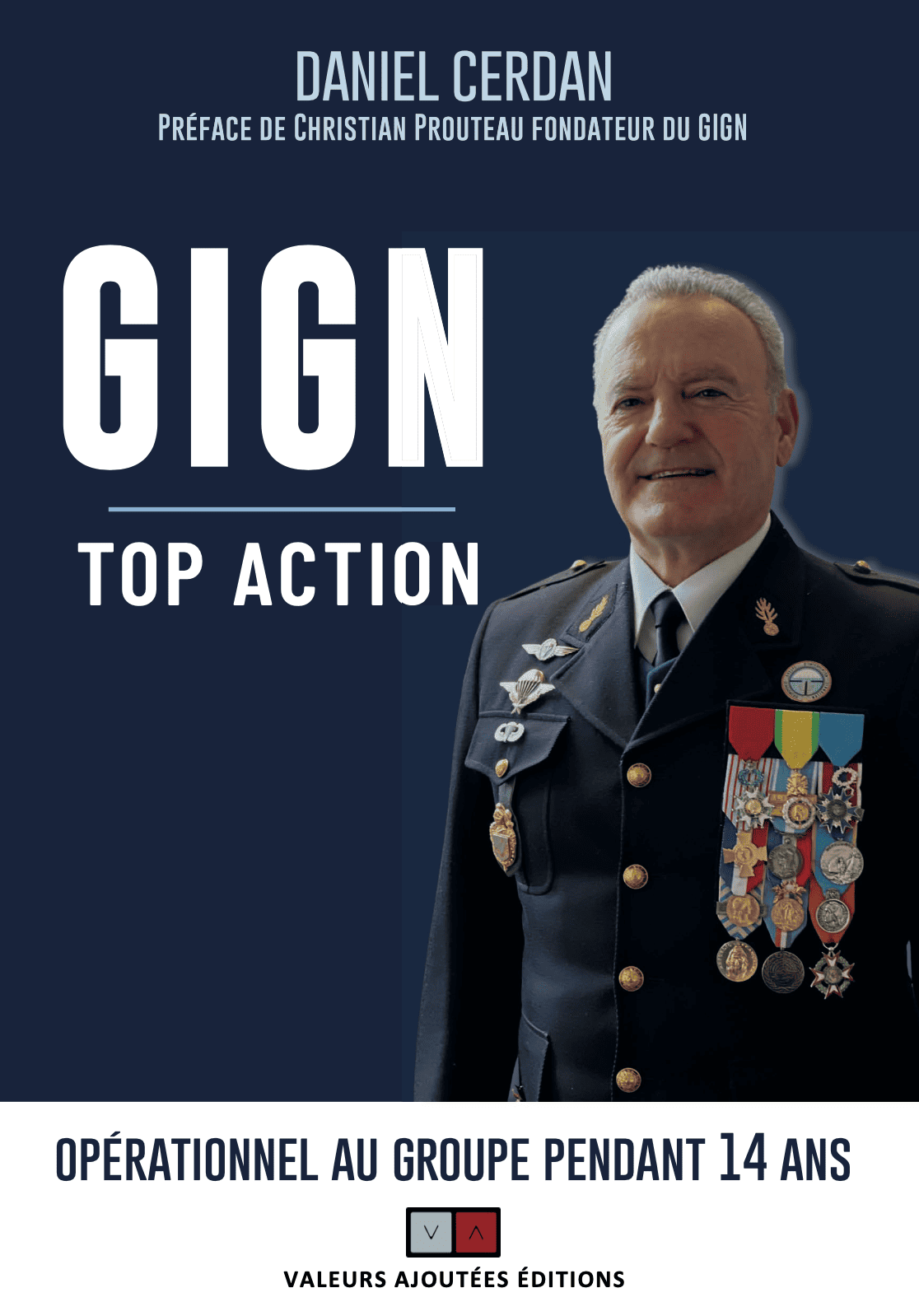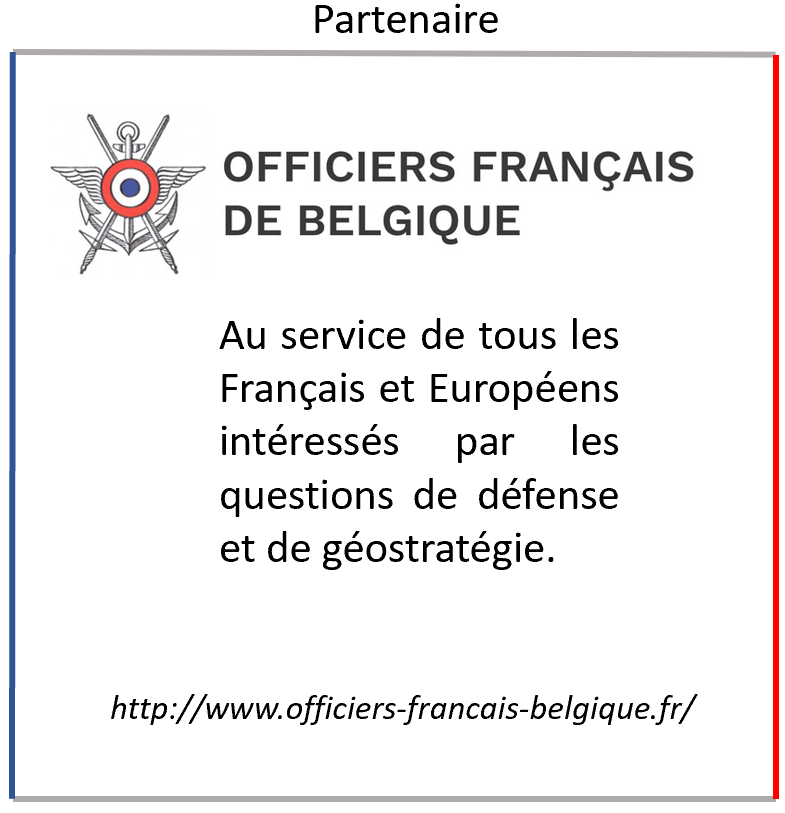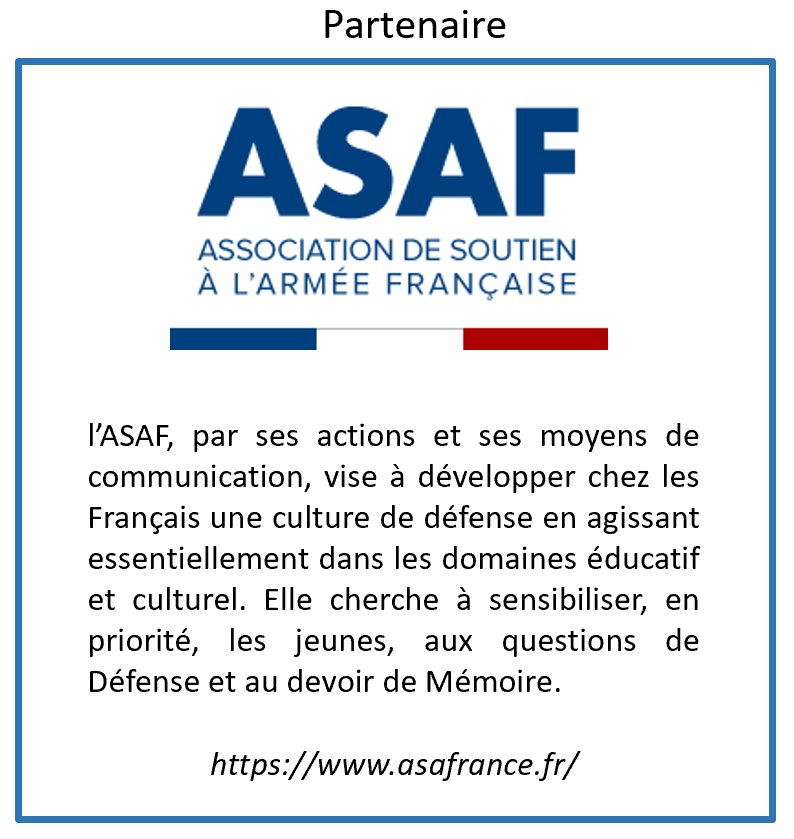Un même défi : regagner de la “masse” dans un monde incertain
Depuis la guerre en Ukraine, les armées européennes redécouvrent une préoccupation qu’elles croyaient rangée au grenier : disposer d’effectifs suffisants pour durer en cas de conflit. L’Allemagne comme la France font le même diagnostic : il faut reconstituer un vivier de citoyens formés, prêts à renforcer l’armée professionnelle.
Mais à partir de ce point commun, les chemins se séparent très vite.
En Allemagne : un formulaire obligatoire et 2 600 € par mois pour convaincre
À Berlin, tout commence par un courrier adressé aux 18 ans dès janvier 2026 : un formulaire où chaque jeune devra dire s’il est prêt à effectuer un service militaire volontaire d’au moins six mois. Tout le monde reçoit la lettre, mais seuls les garçons ont pour l’instant l’obligation d’y répondre.
Les objectifs sont ambitieux :
-
20 000 volontaires en 2026,
-
23 000 en 2027,
-
28 000 en 2028.
Pour attirer, le gouvernement n’a pas lésiné :
-
2 600 € brut par mois,
-
le permis de conduire en partie financé,
-
une formation gratuite en intelligence artificielle,
-
une promesse politique forte : reconstruire une Bundeswehr « prête à faire la guerre ».
À ce prix-là, le volontariat a soudain des airs d’opportunité professionnelle. Quand on vient d’obtenir son bac et qu’on travaille dans un café en attendant la fac – comme Justus, le jeune Berlinois mis en avant dans la presse allemande – l’offre est presque… compétitive.
En France : un service militaire volontaire à bas coût
À Paris, le président Emmanuel Macron, lui aussi, veut proposer un nouveau cadre d’engagement pour les jeunes. Durée envisagée : 10 mois. Volume : 10 000 à 50 000 volontaires par an.
Mais la rémunération évoquée – jamais officiellement confirmée mais largement relayée – tourne plutôt autour de 800 à 1 000 € mensuels.
Même en incluant la nourriture et le logement, l’écart avec l’Allemagne est tel qu’il en devient difficile à ignorer. D’autant qu’en France, un élève officier de Saint-Cyr – la crème de la crème – perçoit 1 500 € net par mois en deuxième année. Autrement dit, le futur lieutenant français sera payé moins demain qu’un soldat de seconde classe volontaire allemand, dès son premier mois d’engagement !
Ce contraste interroge : Que dit-il de notre vision de l’effort national ? Quelle place voulons-nous donner aux jeunes dans la défense ? Et surtout : voulons-nous vraiment attirer des volontaires ?
Deux modèles philosophiquement opposés
Ce n’est pas qu’une question de chiffres. C’est une question de symboles.
En Allemagne, le volontariat militaire est pensé comme :
-
un contrat attractif,
-
un tremplin vers l’emploi,
-
un moyen de recruter massivement dans une armée en manque chronique d’effectifs,
-
un geste politique fort pour accompagner le réarmement du pays.
En France, le volontariat militaire ressemble davantage à :
-
un outil de cohésion nationale,
-
un sas entre jeunesse et armée,
-
un réservoir de renforts en cas de crise,
-
mais sans véritable ambition salariale.
Même objectif stratégique, mais deux philosophies : professionnalisation attractive en Allemagne, citoyenneté mobilisée en France.
L’Europe réarme, mais pas de la même manière
Les pays baltes, les Scandinaves, l’Allemagne, la France : tout le continent révise son rapport à la défense. Mais le cas franco-allemand met en lumière un point essentiel : faire revenir la jeunesse sous les drapeaux ne se fera pas au même prix, au même rythme, ni avec la même intention selon les pays.
L’Allemagne mise sur le portefeuille pour convaincre.
La France mise sur l’esprit civique.
Et il n’est pas interdit de penser que, pour les futurs volontaires, la différence risque de faire… toute la différence.
Deux pays, une même menace, un même projet – et pourtant une rémunération multipliée par 2,5 entre Berlin et Paris. Le service militaire volontaire, censé rapprocher les jeunesses européennes d’un même effort, commence par créer un fossé salarial.
Alors, oui : jeunes Allemands qui rient, jeunes Français qui pleurent. Ou, du moins, qui risquent de regarder par-dessus le Rhin et de se demander : “À compétences égales, pourquoi ne vaudrions-nous pas autant ?”
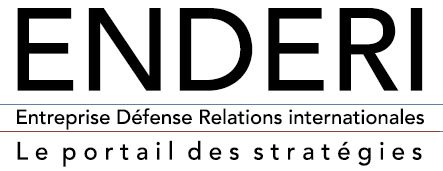
 Diplomatie
Diplomatie