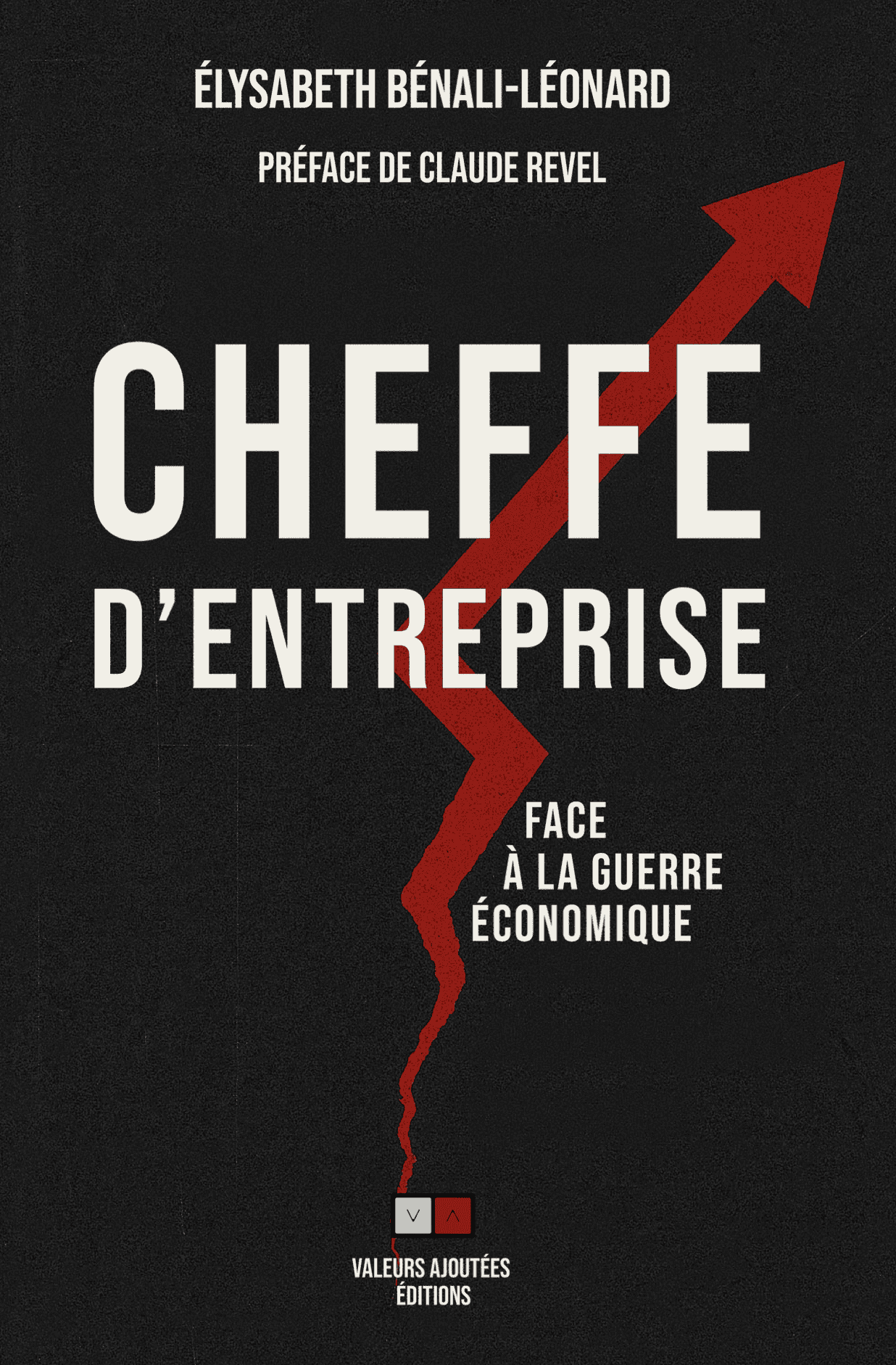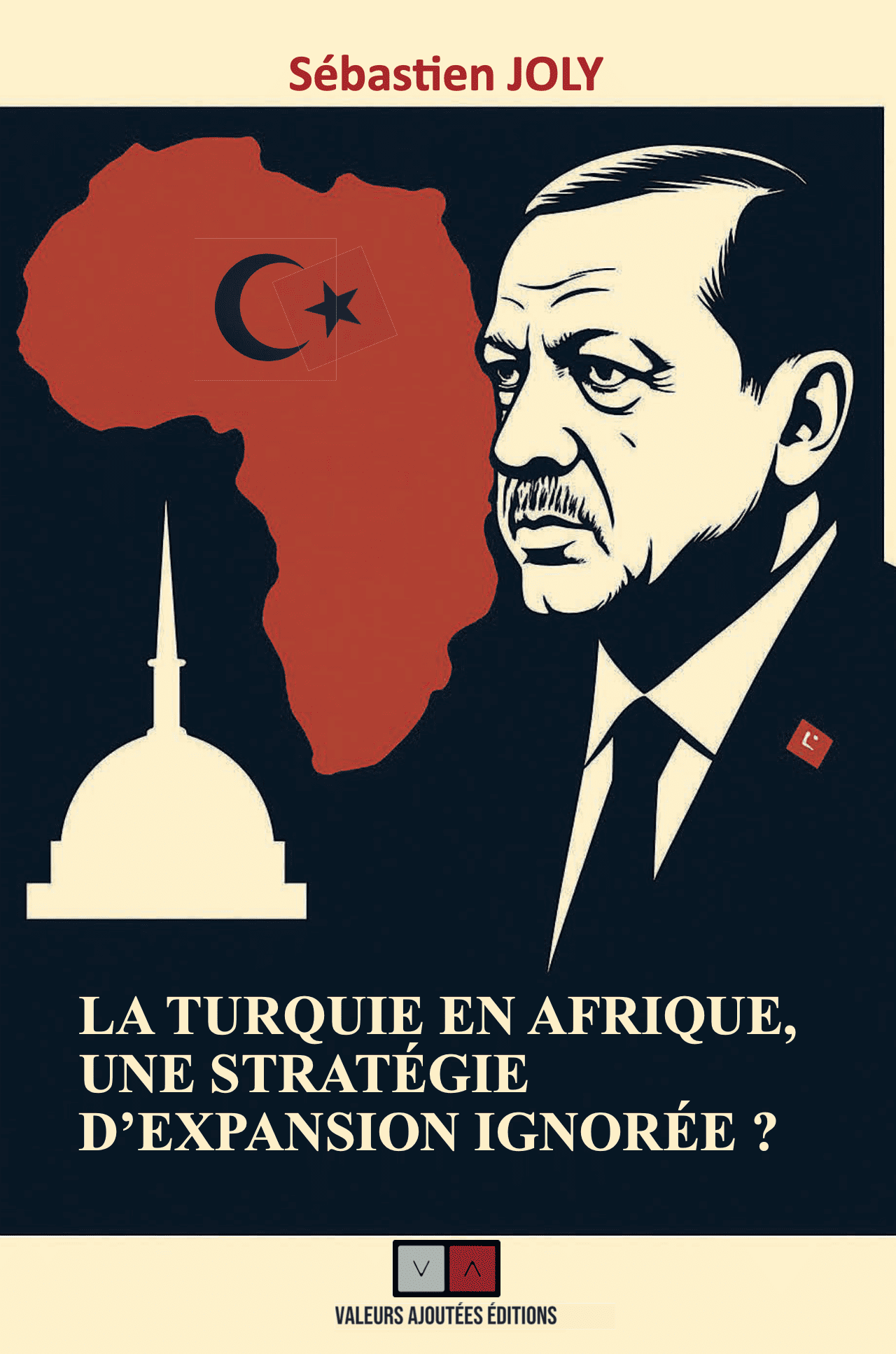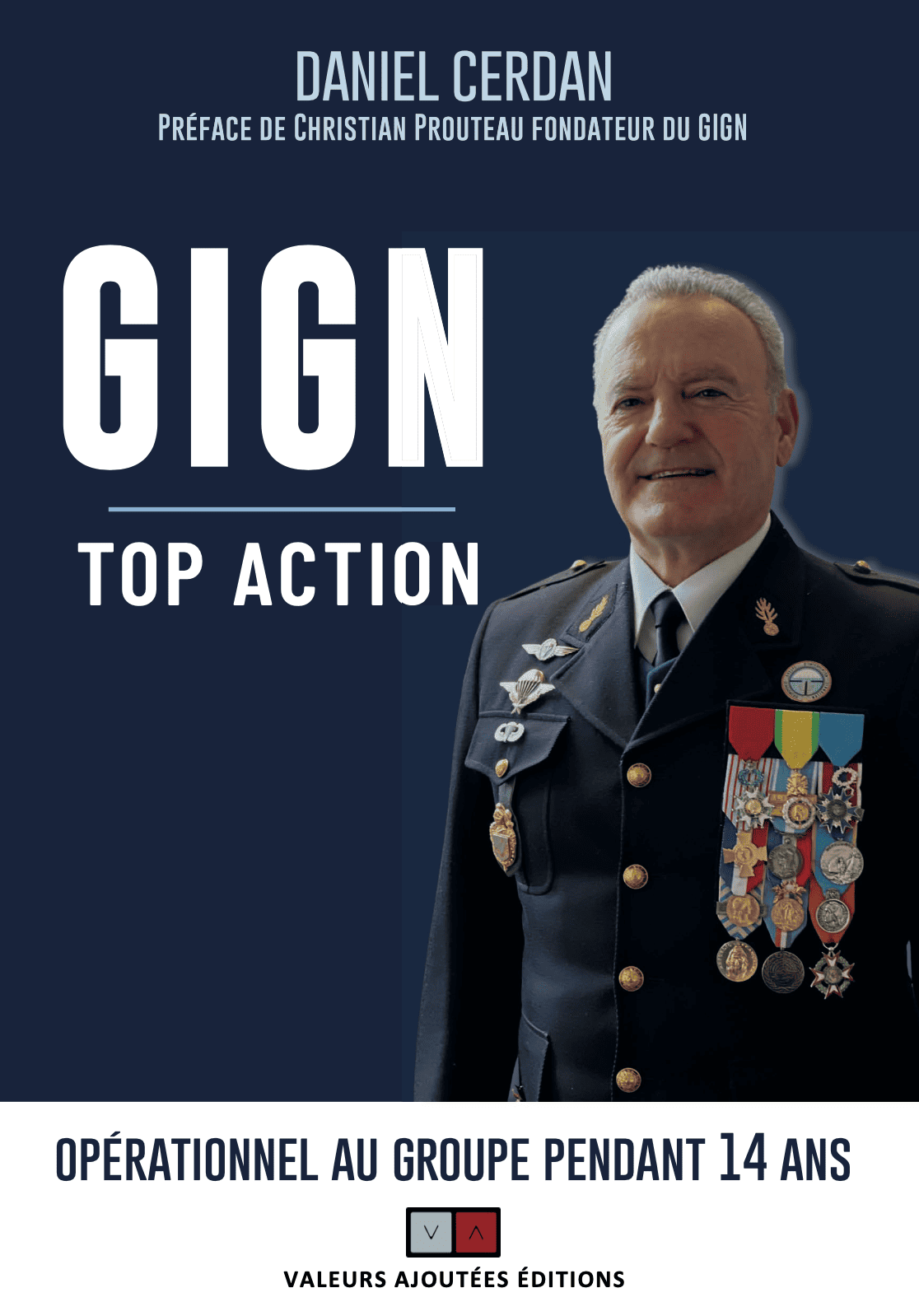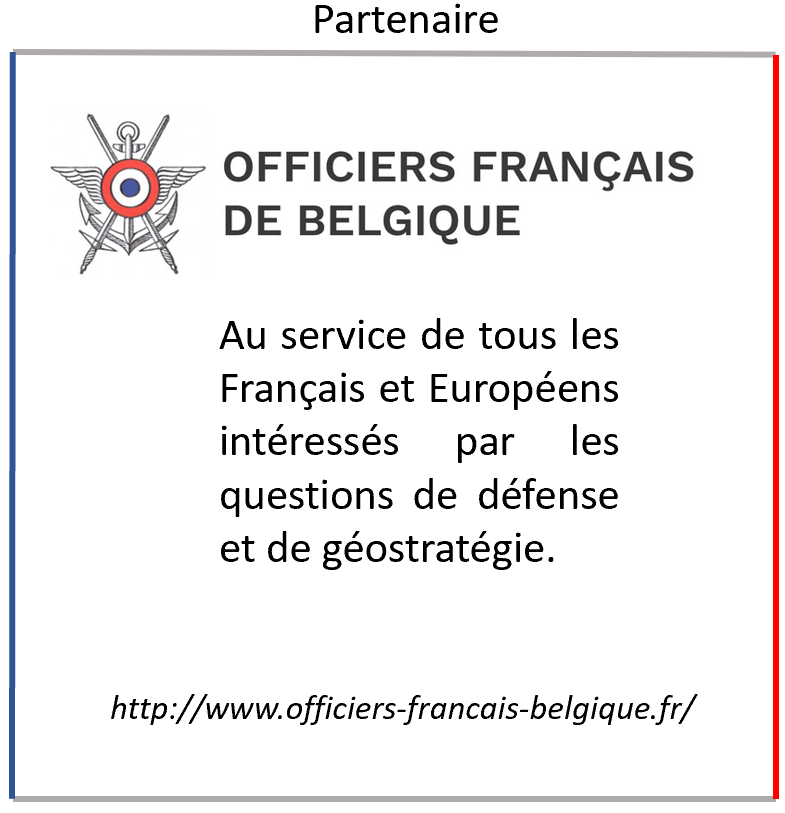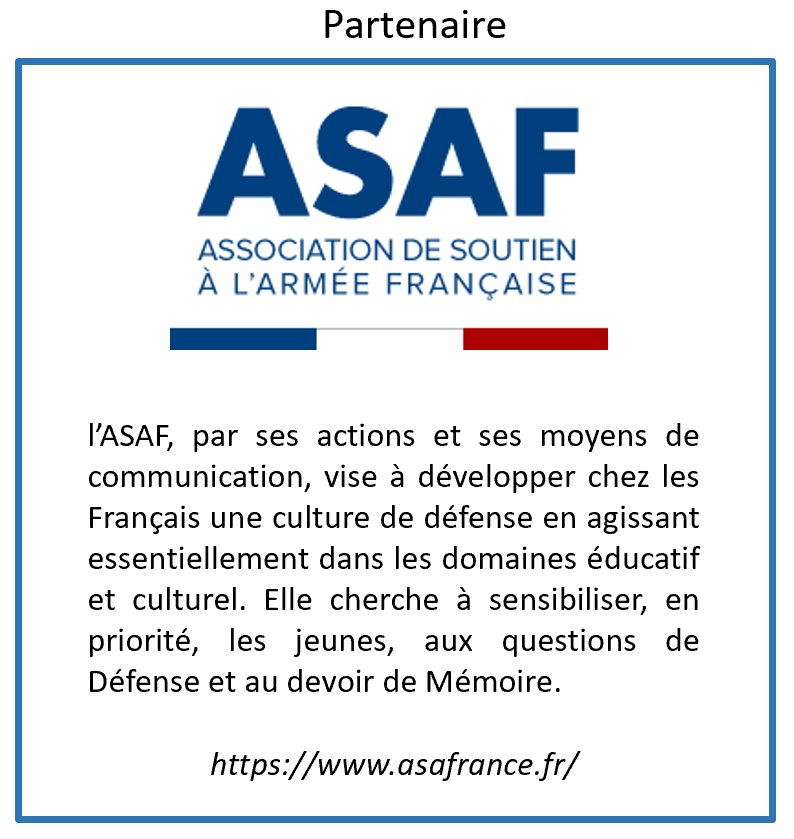La libération des otages a commencé aux premières heures du jour, à 8h (05h GMT), via le corridor de Netzarim, puis à Garya dans le sud de Gaza.
Le processus exige une orchestration complexe. Le passage des otages doit se faire sous supervision internationale, potentiellement avec une force de maintien de la paix. Le transit aura lieu via des couloirs sécurisés et des points de contrôle préalablement définis. L’accord impose aussi la remise des corps des otages décédés.
L’échange définitif a eu lieu le 13 octobre : les 20 otages israéliens encore vivants ont été libérés contre le transfert de 1 900 prisonniers palestiniens vers Gaza et la Cisjordanie. La scène du retour a provoqué des émotions intenses à Tel Aviv, notamment Place des Otages, où familles et citoyens attendaient depuis plus de deux ans.
Complexité diplomatique, garanties et risques
L’accord ne promet pas une paix stabilisée instantanément. La trêve dépendra de la bonne foi des parties et de garanties extérieures. L’ONU, les États-Unis, l’Égypte, le Qatar et la Turquie figurent comme garants du texte. Le Hamas a pris le risque politique de lâcher ses otages survivants, pariant que les États-Unis et les médiateurs tiendraient leurs promesses. Mais cela l’expose. Si Israël reprend des opérations militaires ou si l’accord est violé, la confiance s’effondrera rapidement.
Un autre point de tension : Israël n’a pas accepté de libérer des figures du Hamas comme Marwan Barghouti. Ces omissions peuvent alimenter des critiques sur l’inégalité du deal. Les modalités du retrait sont aussi floues. Israël maintiendra le contrôle de 53 % du territoire sous certaines conditions, selon les premiers termes. Le retrait doit permettre l’accès humanitaire, la reconstruction et la tenue des mécanismes de gouvernance dans Gaza.
Pourquoi cet accord est un tournant — et ses défis
Les otages étaient devenus un symbole de la guerre : leur retour marque un point de bascule politique. L’accord donne un nouveau souffle à l’intervention diplomatique américaine, incarnée par Donald Trump, présent lors des négociations et salué pour son rôle de médiateur.
Mais le défi est immense. Le Hamas doit céder une part de légitimité militaire en échange d’une reconnaissance minimale. Israël, de son côté, accepte d’ouvrir des voies humanitaires, de relâcher des prisonniers souvent accusés d’actes violents et même de céder du terrain. La stabilité future dépendra de la gouvernance de Gaza après la trêve. Le contrôle des zones démilitarisées, la reconstruction, la remise en ordre des institutions locales, la désignation d’une autorité intermédiaire — tout cela devra coexister avec des attentes très élevées de la population civile.
Enfin, le souvenir des précédents accords brisés en 2024 plane sur cet accord. En janvier 2025, un arrangement de plusieurs phases avait déjà été négocié, soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU (résolution 2735), mais n’avait pas tenu. Ce nouvel accord n’est pas une fin de guerre, mais un pari sur la durabilité d’une trêve et sur la volonté internationale de soutenir la reconstruction. Si les promesses ne sont pas honorées, il pourrait être renié ou remis en cause dès que les projecteurs s’éteindront.
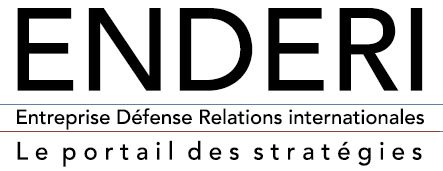
 Diplomatie
Diplomatie